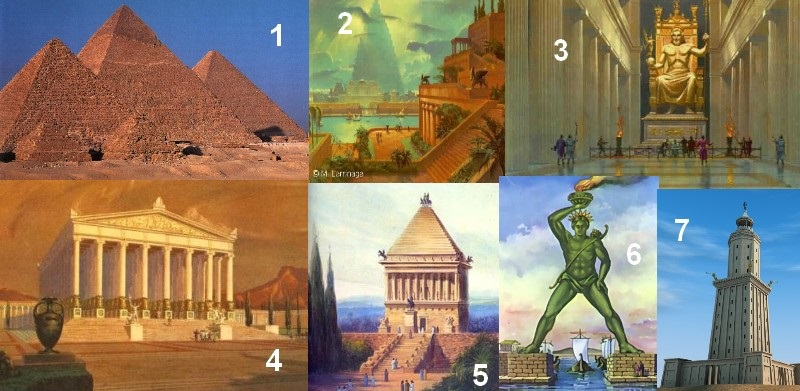L’histoire n’est pas un simple récit d’événements passés. Pour être une discipline scientifique, elle a dû développer une méthode rigoureuse pour analyser et valider ses sources. Cette démarche, connue sous le nom de critique historique, est le fruit d’une longue évolution, de la critique des textes religieux au Moyen Âge à l’approche interdisciplinaire du XXe siècle. Elle a permis de démasquer de célèbres faux, de distinguer les faits des légendes et de poser les fondations d’une histoire scientifique et objective.
En bref : l’origine de la critique historique
- La critique historique est née au Moyen Âge avec la remise en cause des textes religieux.
- L’humaniste Laurent Valla a démasqué la « donation de Constantin », un faux qui légitimait le pouvoir du pape.
- L’imprimerie a facilité la comparaison des textes et l’émergence d’une critique plus systématique.
- La « critique méthodique » du XIXe siècle a posé les bases de l’histoire scientifique, en s’appuyant sur des règles strictes pour valider les sources.
- L’École des Annales au XXe siècle a modernisé cette approche en insistant sur l’interdisciplinarité et l’importance de la problématique.
La critique historique puise son origine dans l’enseignement antique et médiéval à travers les 7 arts libéraux.
Les débuts de la critique : du Moyen Âge à la Renaissance
Les premières formes de critique historique émergent avec la remise en question des textes religieux. Au XIIe siècle, Pierre Abélard utilise la raison et la dialectique pour analyser les écrits des Pères de l’Église. Dans son traité Sic et non (1123), il met en évidence les contradictions apparentes et réelles entre les textes, une démarche audacieuse qui lui vaudra une condamnation.
La critique s’affine avec l’Humanisme et la redécouverte des textes anciens. L’imprimerie, en permettant la reproduction systématique des ouvrages, facilite la comparaison des manuscrits et la recherche du « texte parfait ». Des humanistes comme Laurent Valla appliquent cette méthode à des documents politiques et non plus seulement religieux. En 1442, Valla étudie la donation de Constantin, un texte censé légitimer le pouvoir des papes sur Rome et l’Italie. En analysant le vocabulaire, la grammaire et les anachronismes, il démontre qu’il s’agit d’un faux rédigé au VIIIe siècle, et non au IVe.

La Réforme protestante intensifie cette démarche. Les Bollandistes, un groupe de jésuites, se voient confier la tâche d’établir la critique sur les témoignages relatifs aux saints. Leur travail monumental, les Acta Sanctorum, sépare les faits avérés des légendes. Au XVIIe siècle, Jean Mabillon, dans son œuvre De Re Diplomatica, pose les bases de la diplomatique (l’étude des diplômes) et établit une série de règles pour déterminer la véracité des textes officiels.
La critique méthodique et la naissance de l’histoire scientifique
Au XVIIIe siècle, face à une histoire de plus en plus romancée, la « critique méthodique » voit le jour. Elle se pose en rupture avec l’approche narrative et romanesque de l’histoire, et promeut l’idée d’une histoire scientifique. Cette nouvelle méthode se base sur des règles strictes pour analyser les faits, en utilisant des fiches, des notes en bas de page et une bibliographie pour garantir la traçabilité des sources.
Au XIXe siècle, l’historien allemand Leopold Von Ranke introduit la notion de la recherche de la vérité. Sous son impulsion naissent les Monumenta Germaniae Historica (MGH), un vaste projet qui consiste à éditer de manière critique les sources de l’histoire allemande. Cette démarche combine à la fois la critique externe (vérification de l’authenticité) et la critique interne (analyse de la crédibilité du contenu). La critique historique est à l’origine du révisionnisme historique né dans le cadre de l’Affaire Dreyfus, démontrant que même un jugement établi peut être remis en question.
La problématique : l’approche moderne de l’histoire
Les deux guerres mondiales bouleversent la façon d’écrire l’histoire. Les historiens réalisent que la simple accumulation de faits ne suffit plus. La critique méthodique est alors enrichie par un nouvel élément : la problématique. L’histoire s’articule désormais autour de questions à analyser.
En 1929, Marc Bloch et Lucien Febvre fondent l’École des Annales, qui révolutionne la discipline. Ils insistent sur l’importance de l’interdisciplinarité (utiliser des méthodes issues de la sociologie, de la géographie, de l’économie…) et élargissent la notion de source. Pour eux, le document écrit n’est plus la seule source légitime ; les paysages, les témoignages oraux, les images, tout devient source potentielle d’information. La seconde génération des Annales, menée par Fernand Braudel, va encore plus loin en introduisant des méthodes quantitatives et en repensant la périodisation pour intégrer le temps long.
Au XXe siècle, l’historien prend un rôle social. Il ne se contente plus de raconter des faits, il explique les grands phénomènes historiques et aide la société à comprendre ses propres évolutions et défis. La critique historique est alors l’outil essentiel pour garantir la scientificité de ce travail, au-delà des débats idéologiques.
FAQ : tout savoir sur l’histoire de la critique historique
Qu’est-ce que la critique historique ?
La critique historique est une méthode scientifique d’analyse des documents, des témoignages et des sources pour en déterminer l’authenticité, la véracité et le contexte de production. Elle permet de distinguer les faits des légendes ou des falsifications.
Qui est le père de la critique historique ?
Bien que des démarches critiques aient existé avant, on considère souvent que la critique historique moderne est née au Moyen Âge et a été développée par les humanistes comme Laurent Valla et plus tard par des historiens comme Jean Mabillon au XVIIe siècle, puis par la critique méthodique du XIXe siècle.
Quelle est l’importance de Laurent Valla dans l’histoire de la critique ?
Laurent Valla est célèbre pour avoir démasqué la donation de Constantin. Il a démontré, en s’appuyant sur l’analyse linguistique et historique, que ce document, censé être de l’époque romaine, était en réalité un faux du Moyen Âge. Cette découverte a ébranlé les fondements du pouvoir temporel du pape.
Qu’est-ce que la critique méthodique ?
La critique méthodique est une école historique qui s’est développée au XIXe siècle. Elle a posé les bases d’une histoire scientifique et objective, en insistant sur la nécessité de vérifier systématiquement les sources par des règles strictes (notes, bibliographie, comparaison des documents…).
Quel a été l’apport de l’École des Annales à la critique historique ?
L’École des Annales a révolutionné la discipline au XXe siècle en ajoutant la notion de problématique. Au lieu de simplement raconter des faits, les historiens doivent poser des questions et utiliser une approche interdisciplinaire pour y répondre. Ils ont également élargi le concept de « source historique » à d’autres supports que le document écrit.
Quel est le lien entre l’Affaire Dreyfus et la critique historique ?
L’Affaire Dreyfus est un exemple d’application de la critique historique. Le concept de révisionnisme, qui signifie revoir un jugement ou un fait établi, est né pendant cette affaire. Les historiens ont utilisé les méthodes de la critique pour démontrer l’innocence de Dreyfus et la falsification des preuves.
Pourquoi l’historien doit-il faire preuve d’esprit critique ?
L’esprit critique est essentiel pour l’historien afin de ne pas reproduire des erreurs ou des mensonges. Il doit toujours se poser des questions sur la fiabilité de ses sources, les intentions de l’auteur et les biais éventuels pour reconstruire l’histoire avec la plus grande rigueur possible.
- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026
- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025
- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025
Rejoignez-nous sur Instagram !
Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet