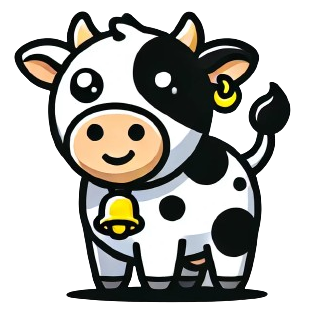Cet article propose un résumé analytique détaillé du livre du sociologue Émile Durkheim, le Suicide, qu’il publie en 1897. Les mots qui sont indiqués entre guillemets sont les mots employés par Durkheim lui-même. Il s’agit de termes aujourd’hui tombés en désuétude ou dont la notion a évolué. L’usage des guillemets n’est employé que pour la première occurrence du mot.
Qu’est-ce que le suicide ?
L’explication exige la comparaison ; la comparaison exige la classification ; la classification exige la définition des faits à classer, à comparer et finalement à expliquer. Conformément aux Règles de la méthode sociologique, Durkheim commence donc son ouvrage de 1897 par une mise en garde contre les notiones vulgares ou praenotiones, tout en insistant sur le fait que
Notre première tâche… doit être de déterminer l’ordre des faits à étudier sous le nom de suicide… nous devons chercher à savoir si, parmi les différentes variétés de mort, certaines ont des qualités communes assez objectives pour être reconnues par tous les observateurs honnêtes, assez spécifiques pour ne pas se retrouver ailleurs et aussi assez proches de celles qu’on appelle communément suicides pour que nous conservions le même terme sans rompre avec l’usage commun.

L’effort initial de Durkheim pour une telle définition suivait en effet l’usage commun, selon lequel on appelle suicide toute mort qui est le résultat immédiat ou éventuel d’un acte positif (par exemple, se tirer une balle) ou négatif (par exemple, refuser de s’alimenter) accompli par la victime elle-même. Mais là, Durkheim se heurte immédiatement à des difficultés, car cette définition ne permet pas de distinguer deux types de mort très différents : la victime d’une hallucination qui saute d’une fenêtre d’un étage en pensant qu’elle est au rez-de-chaussée, et l’individu sain d’esprit qui fait la même chose en sachant qu’il va mourir. La solution évidente,c’est-à-dire restreindre la définition du suicide aux actions destinées à avoir ce résultat, était inacceptable pour Durkheim pour au moins deux raisons :
- Premièrement, comme nous l’avons vu en préambule, Durkheim a toujours essayé de définir les faits sociaux par des caractéristiques facilement vérifiables, et les intentions des agents étaient mal adaptées à cet objectif.
- Deuxièmement, la définition du suicide par la fin recherchée par l’agent exclurait les actions, par exemple, la mère qui se sacrifie pour son enfant, dans lesquelles la mort n’est manifestement pas recherchée mais est néanmoins une conséquence inévitable de l’acte en question, et constitue donc un suicide sous un autre nom.
La caractéristique distinctive des suicides n’est donc pas que l’acte est accompli intentionnellement, mais plutôt qu’il est accompli en connaissance de cause, l’agent sait que la mort sera le résultat de son acte, que la mort soit ou non son objectif. Ce critère suffit à distinguer le suicide, proprement dit, des autres morts que l’on s’inflige inconsciemment ou que l’on ne s’inflige pas du tout ; de plus. Durkheim a insisté sur le fait qu’une telle caractéristique était facilement vérifiable, et que de tels actes formaient ainsi un groupe défini et homogène. D’où la définition de Durkheim : Le suicide s’applique à tous les cas de mort résultant directement ou indirectement d’un acte positif ou négatif de la victime elle-même, dont elle sait qu’il produira ce résultat.
Cette définition a cependant fait l’objet de deux objections immédiates. La première était que cette prescience est une question de degré, variant considérablement d’une personne ou d’une situation à l’autre. A quel moment, par exemple, la mort d’un casse-cou professionnel ou celle d’un homme négligeant sa santé cesse-t-elle d’être un accident pour devenir un suicide ? Mais si Durkheim a posé cette question, c’est moins pour soulever une objection à sa définition que pour en dégager correctement le plus grand avantage : celui d’indiquer la place du suicide dans l’ensemble de la vie morale. Car les suicides, selon Durkheim, ne constituent pas un groupe tout à fait distinct de « phénomènes monstrueux » sans rapport avec d’autres formes de comportement ; au contraire, ils sont reliés à d’autres actes, courageux ou imprudents, par une série ininterrompue de cas intermédiaires. Les suicides, en somme, ne sont qu’une forme exagérée de pratiques courantes.
La seconde objection était que ces pratiques, aussi courantes soient-elles, sont des pratiques individuelles, avec des causes et des conséquences individuelles, qui relèvent donc de la psychologie et non de la sociologie. En fait, Durkheim n’a jamais nié que le suicide puisse être étudié par les méthodes de la psychologie, mais il a insisté sur le fait que le suicide pouvait aussi être étudié indépendamment de ses manifestations individuelles, comme un fait social sui generis. En effet, chaque société possède une aptitude certaine au suicide, dont l’intensité relative peut être mesurée par la proportion de suicides par rapport à la population totale, ou ce que Durkheim appelle le taux de mortalité par suicide, caractéristique de la société considérée. Ce taux, insistait Durkheim, était à la fois permanent (le taux de toute société individuelle était moins variable que celui de la plupart des autres données démographiques principales, y compris le taux de mortalité général) et variable (le taux de chaque société était suffisamment particulier à cette société pour être plus caractéristique de celle-ci que son taux de mortalité général) ; et, de même que le premier serait inexplicable s’il n’était pas le résultat d’un ensemble de caractères distincts, solidaires les uns des autres, et simultanément efficaces malgré des circonstances différentes, le second prouve la qualité concrète et individuelle de ces mêmes caractères, puisqu’ils varient avec le caractère individuel de la société elle-même. Chaque société, conclut Durkheim, est prédisposée à fournir un contingent déterminé de suicides, et c’est cette prédisposition que Durkheim se propose d’étudier sociologiquement.
Ainsi défini, le projet de Durkheim se divisait naturellement en trois parties : premièrement, l’examen des causes extra-sociales suffisamment générales pour avoir un effet possible sur le taux social des suicides (mais qui, en fait, l’influencent peu ou pas du tout) ; deuxièmement, la détermination de la nature des causes sociales, de la manière dont elles produisent leurs effets et de leurs relations avec les conditions individuelles normalement associées aux différents types de suicide ; et troisièmement, l’exposé plus précis de l’aptitude au suicide décrite ci-dessus, de sa relation avec d’autres faits sociaux, et des moyens par lesquels cette tendance collective pourrait être contrée.
Causes extra-sociales
Selon Durkheim, il existe, a priori, deux sortes de causes extra-sociales suffisamment générales pour avoir une influence sur le taux de suicide. Tout d’abord, dans la constitution psychologique individuelle, il peut exister un penchant, normal ou pathologique, variant d’un pays à l’autre, qui conduit directement au suicide. Ensuite, la nature de l’environnement physique extérieur (climat, température, etc.) pourrait indirectement avoir le même effet. Durkheim les aborde tour à tour.
Le taux annuel de certaines maladies, comme le taux de suicide, est à la fois relativement stable pour une société donnée et sensiblement variable d’une société à l’autre ; et puisque la folie est une telle maladie, la démonstration que le suicide est la conséquence de la folie (un fait psychologique) rendrait bien compte de ces caractéristiques de permanence et de variabilité qui avaient conduit Durkheim à suggérer que le suicide était un fait social sui generis. Durkheim était donc particulièrement soucieux d’éliminer la folie comme cause probable du suicide, et il l’a fait en attaquant cette hypothèse sous ses deux formes les plus courantes : l’opinion selon laquelle le suicide lui-même est une forme spéciale de folie, et l’opinion selon laquelle le suicide est simplement un effet de divers types de folie. Durkheim a rejeté la première en classant la folie suicidaire dans la catégorie des monomanies, une forme de maladie mentale limitée à un seul acte ou objet, et en faisant valoir qu’aucun exemple incontestable de cette monomanie n’avait encore été démontré. Il a rejeté la seconde au motif que tous les suicides commis par des aliénés sont soit dépourvus de toute délibération et de tout motif, soit fondés sur des motifs purement hallucinatoires, tandis que de nombreux suicides sont doublement identifiables comme étant délibérés et découlant de représentations impliquées dans cette délibération qui ne sont pas purement hallucinatoires. Il existe donc de nombreux suicides qui ne sont pas liés à la folie.
Mais qu’en est-il des états psychopathiques qui ne relèvent pas de la folie, « neurasthénie » et alcoolisme, mais qui sont néanmoins fréquemment associés au suicide ? Durkheim a répondu en montrant que le taux de suicide social n’a pas de relation précise avec celui de la neurasthénie, et que cette dernière n’a donc pas d’effet nécessaire sur le premier ; et l’alcoolisme a été écarté comme cause putative sur la preuve que les distributions géographiques de la consommation d’alcool et des poursuites pour alcoolisme n’ont aucun rapport avec celles des suicides. Un état psychopathique, conclut Durkheim, peut prédisposer des individus à se suicider, mais il n’est jamais en soi une cause suffisante de la permanence et de la variabilité des taux de suicide.
Après avoir écarté les états pathologiques comme classe de causes, Durkheim se tourne vers les conditions psychologiques normales (« race » et hérédité) qui, là encore, sont suffisamment générales pour rendre compte des phénomènes en question. L’opinion selon laquelle le suicide est la conséquence de tendances inhérentes à chaque grand type social, par exemple, a été mise à mal par les énormes variations des taux de suicide social observées au sein d’un même type, ce qui suggère que les différents niveaux de civilisation sont beaucoup plus déterminants. Mais l’argument selon lequel le suicide est héréditaire devait d’abord être distingué de l’opinion plus modérée selon laquelle on hérite d’une prédisposition au suicide ; car cette dernière, comme dans le cas de la neurasthénie, n’est pas du tout une explication du suicide. L’argument le plus fort, à savoir que l’on hérite d’un mécanisme psychologique semi-autonome qui donne lieu au suicide automatiquement, a ensuite été rejeté parce que sa manifestation la plus spectaculaire (la régularité avec laquelle le suicide apparaît parfois dans la même famille) peut être expliquée par d’autres causes (contagion), et que, comme dans les types raciaux, il existe des variations structurées au sein de la même famille (entre maris et femmes) qui, selon cette hypothèse, seraient inexplicables.
Mais si les prédispositions psychologiques normales ou anormales ne sont pas, par elles-mêmes, des causes suffisantes de suicide, ces prédispositions ne pourraient-elles pas, de concert avec des facteurs cosmiques (climat, température saisonnière, etc.), avoir un tel effet déterminant ? La conjonction de ces prédispositions avec le climat, répondait Durkheim, n’a pas une telle influence ; car si la répartition géographique des suicides en Europe varie selon la latitude et donc grossièrement selon le climat aussi, ces variations s’expliquent mieux par des causes sociales. La suggestion de Montesquieu selon laquelle les pays froids et brumeux sont les plus favorables au suicide est également discréditée par le fait que, dans tous les pays pour lesquels des statistiques sont disponibles, le taux de suicide est plus élevé au printemps et en été qu’en automne et en hiver.
Le suicide est-il donc, comme le croyaient les statisticiens italiens Ferri et Morselli, un effet de l’influence mécanique de la chaleur sur les fonctions cérébrales ? Durkheim objecte ici, pour des raisons à la fois conceptuelles et empiriques, que cette théorie suppose que l’antécédent psychologique constant du suicide est un état d’excitation extrême, alors qu’en fait il est fréquemment précédé d’une dépression ; et, en tout cas, que le taux de suicide est en baisse en juillet et en août, et ne varie donc pas régulièrement avec la température. L’argument italien révisé, selon lequel c’est le contraste entre le froid qui s’en va et le début de la saison chaude qui stimule les prédispositions psychologiques, a été également rejeté par Durkheim comme incompatible avec la parfaite continuité (augmentation régulière de janvier à juin, diminution régulière de juillet à décembre) de la courbe représentant les variations mensuelles du taux de suicide.
Conformément à l’argumentation des Règles (chapitre VI), Durkheim insiste sur le fait qu’une telle variation parfaitement continue ne peut s’expliquer que par des causes variant elles-mêmes avec la même continuité ; et, comme premier indice de la nature de ces causes, il fait remarquer que la part proportionnelle de chaque mois dans le nombre total des suicides annuels est parfaitement parallèle à la durée moyenne du jour à la même époque de l’année. D’autres indices suivent : le suicide est plus fréquent le jour que la nuit, le matin et l’après-midi qu’à midi, et les jours de semaine que les week-ends (sauf une augmentation des suicides féminins le dimanche). Dans tous les cas, observe Durkheim, le suicide augmente dans les mois, les jours de la semaine et les heures de la journée où la vie sociale est la plus active, et diminue lorsque l’activité collective décline. Anticipant l’argument du deuxième livre, Durkheim suggère donc que le suicide est la conséquence de l’intensité de la vie sociale ; mais avant de pouvoir expliquer comment une telle cause peut produire un tel effet, Durkheim doit faire face à une autre théorie psychologique, l’argument de Tarde selon lequel les faits sociaux en général, et le suicide en particulier, peuvent être expliqués comme la conséquence de l’imitation.
Le terme « imitation », commença Durkheim, est utilisé indistinctement pour expliquer trois groupes de faits très différents :
- Ce processus complexe par lequel des états de conscience individuels agissent et réagissent les uns sur les autres de manière à produire un nouvel état collectif sui generis.
- Cette impulsion qui nous conduit à nous conformer aux manières, aux coutumes et aux pratiques morales de nos sociétés.
- Cette reproduction automatique, largement non préméditée, d’actions simplement parce qu’elles se sont produites en notre présence ou que nous en avons entendu parler.
La première, insiste Durkheim, peut difficilement être appelée imitation, car elle n’implique aucun acte de reproduction authentique ; la seconde implique un acte de reproduction, mais un acte inspiré à la fois par la nature spécifique des manières, des coutumes et des pratiques en question, et par les sentiments spécifiques de respect ou de sympathie qu’elles inspirent, et donc un acte mal décrit par le terme imitation ; ce n’est que dans le troisième cas, où l’acte est un simple écho de l’original, et n’est soumis à aucune cause extérieure à lui-même, que le terme est justifié. D’où la définition de Durkheim :
Il y a imitation lorsque l’antécédent immédiat d’un acte est la représentation d’un acte semblable, précédemment accompli par quelqu’un d’autre ; sans qu’aucune opération mentale, explicite ou implicite, portant sur la nature intrinsèque de l’acte reproduit, n’intervienne entre la représentation et l’exécution.
Ainsi définie, bien sûr, l’imitation est réduite à un phénomène purement psychologique ; car si la synthèse des consciences individuelles en un état collectif sui generis et la conformité à des croyances et pratiques obligatoires sont toutes deux hautement sociales, l’imitation proprement dite est une simple répétition, ne créant aucun lien intellectuel ou moral entre son agent et son antécédent. Nous imitons d’autres êtres humains de la même manière que nous reproduisons les sons de la nature, les objets physiques ou les mouvements d’animaux non humains ; et comme aucun élément clairement social n’intervient dans le second cas, il n’y en a pas non plus dans le premier. Suggérer que le taux de suicide pourrait s’expliquer par l’imitation, c’était donc suggérer qu’un fait social pourrait s’expliquer par un fait psychologique, une possibilité que Durkheim avait déjà niée dans Les Règles.
La définition de Durkheim a clairement réduit le nombre de suicides attribuables à l’imitation. Mais elle ne les élimine pas, bien au contraire. Durkheim insistait sur le fait qu’il n’existait aucun autre phénomène aussi « contagieux » que le suicide. Mais il ne s’ensuit pas que cette contagiosité ait nécessairement des conséquences sociales, c’est-à-dire qu’elle affecte le taux de suicide social, car ses conséquences peuvent au contraire être purement individuelles et sporadiques : et si l’imitation n’affecte pas le taux de suicide, il est douteux ( pace Tarde) qu’elle ait quelque conséquence sociale que ce soit, car aucun phénomène n’est plus affecté par l’imitation que le suicide.
Si, d’autre part, l’imitation influence les taux de suicide, Durkheim a suggéré que cela devrait se refléter dans la distribution géographique des suicides, le taux typique d’un pays devrait être transmis à ses voisins ; et, en effet, des zones géographiques contiguës révèlent des taux de suicide similaires. Mais une telle diffusion géographique des suicides pourrait tout aussi bien s’expliquer par la « diffusion » parallèle d’influences sociales distinctes dans une même région. Outre la similitude des taux dans des zones géographiquement contiguës, l’hypothèse de l’imitation exige donc qu’il existe un modèle d’activité suicidaire particulièrement intense, et que cette activité soit suffisamment visible pour remplir sa fonction de modèle à imiter. Ces conditions sont en fait remplies par les grands centres urbains des pays d’Europe occidentale ; nous devrions donc nous attendre à ce que la répartition géographique des suicides révèle un modèle de concentration autour des grandes villes, avec des cercles concentriques d’activité suicidaire progressivement moins intense rayonnant vers la campagne. Au lieu de cela, nous constatons que le suicide se produit en masses à peu près homogènes dans de vastes régions sans noyau central, observation qui suggère non seulement l’absence totale de toute influence locale de l’imitation, mais la présence des causes beaucoup plus générales du milieu social. Mais ce qui est le plus décisif, c’est qu’un changement brusque de ce milieu social s’accompagne d’un changement tout aussi brusque du taux de suicide, changement qui ne se reflète pas au-delà des limites du milieu social en question, et qui pourrait donc difficilement être expliqué comme la conséquence de l’imitation.
Mais l’argumentation de Durkheim allait en fait beaucoup plus loin que cette négation du fait que, malgré ses effets individuels, l’imitation est une cause insuffisante des variations du taux de suicide ; car il insistait, du reste, sur le fait que l’imitation seule n’a aucun effet sur le suicide. Cette extension de son argumentation était la conséquence de l’engagement théorique plus général de Durkheim en faveur de l’idée que la pensée d’un acte n’est jamais suffisante pour produire l’acte lui-même, à moins que la personne qui pense ne soit déjà ainsi disposée ; et les dispositions en question, bien sûr, sont le résultat de causes sociales. L’imitation n’est donc pas une cause réelle, même des suicides individuels :
Elle ne fait qu’exposer un état qui est la véritable cause génératrice de l’acte, conclut Durkheim, et qui aurait probablement produit son effet naturel même si l’imitation n’était pas intervenue, car il faut que la prédisposition soit très forte pour qu’une affaire aussi légère puisse la traduire en action.
Causes sociales et types sociaux
L’argumentation de Durkheim jusqu’ici est un parfait exemple de son caractéristique argument par élimination, soit le rejet systématique des explications alternatives d’un phénomène donné afin de donner de l’autorité au seul candidat restant. Il prétend ainsi avoir démontré que, pour chaque groupe social, il existe une tendance spécifique au suicide qui ne peut s’expliquer ni par la constitution organique-psychique des individus ni par la nature du milieu physique ; et comme l’a déjà laissé entendre sa discussion sur les variations géographiques et saisonnières du suicide, la tendance en question doit donc être, en soi, un phénomène collectif, et doit dépendre de causes sociales.
Mais existe-t-il, en fait, une tendance suicidaire « unique et indestructible » ? Ou bien en existe-t-il plusieurs, qu’il convient de distinguer les unes des autres et d’étudier séparément ? Durkheim s’était déjà penché sur cette difficulté dans le Livre premier, à propos du suicide par aliénation mentale, et sa solution y est reprise ici. En bref, la tendance suicidaire, unique ou non, n’est observable que dans ses manifestations individuelles (suicides individuels) ; Durkheim proposait donc de classer les suicides en types ou espèces distincts, selon leurs similitudes et leurs différences, en partant du principe qu’il y aurait autant de types que de suicides ayant les mêmes caractéristiques essentielles, et autant de tendances que de types.
Cette solution, cependant, soulève immédiatement un autre problème. Dans son traitement des suicides par aliénation mentale, Durkheim avait à sa disposition de nombreuses et bonnes descriptions de cas individuels, de l’état psychologique de l’agent avant l’acte, de ses préparatifs pour commettre l’acte, de la manière dont l’acte a été accompli, etc. Mais ces données n’étaient presque pas disponibles pour les suicides commis par des personnes saines d’esprit, ce qui rendait impossible la classification selon les manifestations extérieures. Durkheim a donc été contraint de modifier sa stratégie, voire d’inverser l’ordre d’étude, en adoptant un système de classification étiologique plutôt que morphologique. Partant du principe, comme toujours, que tout effet donné a une, et une seule, cause correspondante, Durkheim soutient qu’il doit y avoir autant de types spéciaux de suicide que de causes spéciales les produisant.
Comment, alors, déterminer les causes du suicide ? Une réponse consistait simplement à s’appuyer sur les registres statistiques des « motifs présumés du suicide » (apparemment interprétés comme une cause) tenus par les fonctionnaires dans la plupart des sociétés modernes ; mais, malgré sa commodité et sa plausibilité évidentes, Durkheim a rejeté cette ressource pour au moins deux raisons. Premièrement, ces « statistiques sur les motifs des suicides » étaient en fait des statistiques sur les opinions des fonctionnaires concernant ces motifs, qui représentaient donc non seulement des évaluations difficiles de faits matériels, mais aussi des explications et des évaluations encore plus difficiles d’actions exécutées à volonté. Deuxièmement, indépendamment de la crédibilité de ces rapports, Durkheim niait tout simplement que les motifs soient de véritables causes, une position caractéristique qu’il soutenait en soulignant le contraste entre des proportions relativement constantes de différentes classes d’explications de motifs (à la fois dans le temps et dans les différents groupes professionnels) et des taux de suicide eux-mêmes extrêmement variables (dans la même période et dans les mêmes groupes professionnels). Ces raisons auxquelles on attribue les suicides, insiste donc Durkheim, ne sont que des causes apparentes, des répercussions individuelles d’états plus généraux qu’elles n’expriment qu’imparfaitement :
On peut dire qu’elles indiquent les points faibles des individus, où le courant extérieur porteur de l’impulsion à l’autodestruction trouve le plus facilement à s’introduire. Mais elles ne font pas partie de ce courant lui-même, et par conséquent ne peuvent nous aider à le comprendre.
Faisant fi de ces répercussions individuelles, Durkheim se tourne donc directement vers les états des divers milieux sociaux (confessions religieuses, société familiale et politique, groupes professionnels) à travers lesquels se produisent les variations des taux de suicide, et dans lesquels on pourrait trouver leurs causes.
Le suicide égoïste
Durkheim s’est d’abord interrogé sur l’influence des différentes confessions religieuses sur le suicide. Si l’on observe une carte de l’Europe occidentale, par exemple, on constate que là où les protestants sont les plus nombreux, le taux de suicide est le plus élevé, que là où les catholiques prédominent, il est beaucoup plus faible, et que l’aptitude au suicide des juifs est encore plus faible, mais à un degré moindre, que celle des catholiques. Comment expliquer ces données ?
Là encore, Durkheim a escorté le rendu par un argument par élimination. Dans de nombreuses sociétés observées, par exemple, les juifs et les catholiques sont moins nombreux que les protestants ; il est donc tentant d’expliquer leur taux de suicide inférieur comme la conséquence de cette discipline morale rigoureuse que les minorités religieuses s’imposent parfois face à l’hostilité des populations environnantes. Mais une telle explication, observa Durkheim, ignore au moins trois faits : premièrement, le suicide est trop peu l’objet d’une condamnation publique pour que l’hostilité religieuse ait cet effet ; deuxièmement, l’hostilité religieuse produit fréquemment non pas le conformisme moral de ceux contre qui elle est dirigée, mais plutôt leur rébellion contre elle ; et troisièmement, le taux de suicide réduit des catholiques par rapport aux protestants est indépendant de leur statut de minorité, même en Espagne. Les catholiques se suicident moins fréquemment.
Le dernier point en particulier suggérait une autre explication, à savoir que la cause de la baisse du taux de suicide se trouve dans la nature même de la confession religieuse. Mais une telle explication, insiste Durkheim, ne peut pas se référer aux percepts religieux de la confession, car les catholiques et les protestants y interdisent le suicide avec la même insistance ; l’explication doit plutôt provenir d’une des caractéristiques plus générales qui les différencient, et cette caractéristique, en fait :
la seule différence essentielle entre le catholicisme et le protestantisme est que le second permet le libre examen dans une plus grande mesure que le premier.
Mais si la propension du protestantisme au suicide doit donc être liée à son esprit de libre recherche, cette « libre recherche » elle-même nécessite une explication, car elle apporte autant de tristesse que de bonheur, et n’est donc pas « intrinsèquement désirable ». Pourquoi, alors, les hommes recherchent-ils et même exigent-ils une telle liberté ? La réponse de Durkheim :
La réflexion ne se développe que si son développement devient impératif, c’est-à-dire si l’on constate que certaines idées et certains sentiments instinctifs qui ont jusqu’ici guidé convenablement la conduite ont perdu leur efficacité. C’est alors que la réflexion intervient pour combler le vide qui est apparu, mais qu’elle n’a pas créé.
En d’autres termes, le protestantisme concède une plus grande liberté de pensée à l’individu parce qu’il a moins de croyances et de pratiques communément admises. En effet, c’est cette possession d’un credo commun et collectif qui, pour Durkheim, était l’essence même de la société religieuse et qui la distinguait de ces liens purement temporels qui unissent les hommes par l’échange et la réciprocité des services, mais qui permettent et même présupposent des différences ; et, précisément dans la mesure où le protestantisme était dépourvu d’un tel credo, il était une église moins fortement intégrée que son homologue catholique romain.
Durkheim suggère ensuite que cette explication est compatible avec au moins trois autres observations. Premièrement, elle expliquerait les taux de suicide encore plus faibles des Juifs qui, en réponse à l’hostilité dont ils étaient l’objet, ont établi de solides liens communautaires de pensée et d’action, ont pratiquement éliminé les divergences individuelles et ont ainsi atteint un degré élevé d’unité, de solidarité et d’intégration. Deuxièmement, de tous les grands pays protestants, l’Angleterre a le taux de suicide le plus bas ; et elle a aussi la plus intégrée des églises protestantes. Et troisièmement, puisque la connaissance est la conséquence naturelle de la libre recherche, nous devrions nous attendre à ce que le suicide augmente avec son acquisition, et Durkheim n’a eu aucun mal à démontrer que c’était le cas.
Cette dernière démonstration a toutefois soulevé une anomalie : les Juifs, qui sont à la fois très instruits et ont un faible taux de suicide. Mais pour Durkheim, il s’agit de la proverbiale exception qui confirme la règle. Car le juif cherche à s’instruire, non pas pour remplacer les croyances traditionnelles par une réflexion individuelle, mais pour se protéger de l’hostilité des autres par son savoir supérieur. « L’exception », observe Durkheim, « n’est donc qu’apparente » ; elle confirme même la loi. En effet, elle prouve que si la tendance au suicide est grande dans les milieux instruits, cela est dû, comme nous l’avons dit, à l’affaiblissement des croyances traditionnelles et à l’état d’individualisme moral qui en résulte ; car elle disparaît lorsque l’éducation a une autre cause et répond à d’autres besoins.
Enfin, il est important de noter que l’effet combiné de ces observations sur les confessions religieuses et le suicide était une célébration implicite de la Troisième République en général et de son programme d’éducation laïque en particulier. En effet, comme Durkheim se plaisait à le préciser, la corrélation, depuis longtemps reconnue, entre l’accroissement des connaissances et le suicide ne pouvait être interprétée comme une cause de l’un ou de l’autre ; au contraire, les connaissances et le suicide sont des effets indépendants d’une cause plus générale, le déclin des croyances traditionnelles. De plus, une fois que ces croyances ont décliné, elles ne peuvent pas être rétablies artificiellement, et donc la libre recherche et la connaissance qui en résulte deviennent nos seules ressources dans l’effort pour les remplacer. Enfin, Durkheim avait montré que l’effet prophylactique de la religion sur le suicide ne devait pas grand-chose à sa condamnation du suicide, à son idée de Dieu ou à sa promesse d’une vie future ; la religion protège plutôt l’homme du suicide
parce qu’elle est une société. Ce qui constitue cette société, c’est l’existence d’un certain nombre de croyances et de pratiques communes à tous les fidèles, traditionnelles et donc obligatoires. Plus ces états d’esprit collectifs sont nombreux et forts, conclut Durkheim, plus l’intégration de la communauté religieuse est forte, et aussi plus sa valeur préservatrice est grande.
Mais si la religion préserve ainsi les hommes du suicide parce qu’elle est une société, d’autres sociétés ou groupes sociaux ou de socialisation (par exemple, la famille et la société politique) devraient avoir le même effet. Après avoir mis au point une mesure statistique de l’immunité au suicide dont jouissent divers groupes, Durkheim a pu montrer, par exemple, que si le mariage seul a un effet protecteur contre le suicide, celui-ci est limité et ne profite qu’aux hommes ; la cellule familiale élargie, en revanche, fournit une immunité que le mari et la femme partagent. De même, lorsqu’un partenaire conjugal meurt, le survivant perd un certain degré d’immunité suicidaire ; mais cette perte est moins la conséquence de la rupture du seul lien conjugal que du choc plus général que le survivant doit subir au sein de la famille. Enfin, l’immunité suicidaire augmente avec la taille de la famille, ce que Durkheim attribue au plus grand nombre et à l’intensité des sentiments collectifs produits et renforcés de façon répétée par le groupe le plus important.
De même, l’examen des sociétés politiques a montré que le suicide, assez rare dans les premiers stades d’une société, augmente à mesure que cette société mûrit et se désintègre. En revanche, lors de troubles sociaux ou de grandes guerres populaires, le taux de suicide diminue, ce qui, selon Durkheim, ne peut être interprété que d’une seule façon :
[Ces troubles] éveillent les sentiments collectifs, stimulent l’esprit de parti et le patriotisme, la foi politique et la foi nationale, et, concentrant l’activité vers une seule fin, provoquent au moins temporairement une intégration plus forte de la société.
Le suicide varie donc inversement au degré d’intégration des groupes religieux, domestiques et politiques dont l’individu fait partie ; en bref, à mesure qu’une société s’affaiblit ou se désintègre, l’individu dépend moins du groupe, dépend davantage de lui-même et ne reconnaît pas de règles de conduite autres que celles fondées sur les intérêts privés. Durkheim a appelé cet état d’individualisme excessif, l’égoïsme, et le type particulier de mort auto-infligée qu’il produit, le suicide égoïste.
Mais pourquoi l’individualisme provoque-t-il ainsi le suicide ? Le point de vue traditionnel, selon lequel l’homme, de par sa nature psychologique, ne peut vivre sans une raison transcendante et éternelle au-delà de cette vie, a été rejeté parce que, si notre désir d’immortalité était si grand, rien dans cette vie ne pourrait nous satisfaire ; alors qu’en fait, nous prenons du plaisir dans nos vies temporelles, et les plaisirs que nous prenons ne sont pas seulement physiques et individuels, mais aussi moraux et sociaux, dans leur origine et dans leur but. Durkheim revient ainsi à la conception de la dualité de la nature humaine que l’on trouve pour la première fois dans De la Division du travail social, ouvrage qu’il tire de sa thèse, et qu’il publie en 1893 :
L’homme social se superpose à l’homme physique. L’homme social présuppose nécessairement une société qu’il exprime ou sert. Si celle-ci se dissout, si nous ne pouvons plus la sentir dans son existence et son action autour de nous et au-dessus de nous, tout ce qui est social en nous est privé de tout fondement objectif…. Nous sommes donc privés de raisons d’exister : car la seule vie à laquelle nous pouvions nous accrocher ne correspond plus à rien de réel ; la seule existence encore fondée sur la réalité ne répond plus à nos besoins… Il n’y a donc plus rien à quoi s’accrocher pour nos efforts, et nous les sentons se perdre dans le vide.
C’est donc dans ce sens social (et non plus psychologique) que notre activité a besoin d’un objet qui la transcende ; car un tel objet est implicite dans notre constitution morale elle-même, et ne peut être perdu sans que cette constitution perde sa raison d’être au même degré. Dans cet état de confusion morale, la moindre cause de découragement donne naissance à des résolutions autodestructrices désespérées ; une tendance suicidaire qui infecte non seulement les individus mais des sociétés entières ; et, précisément parce que ces courants intellectuels sont collectifs, ils imposent leur autorité à l’individu et le poussent encore plus loin dans la direction où il est déjà par disposition interne enclin à aller. Ironiquement donc, l’individu se soumet à l’influence de la société au moment même où il s’en libère :
Si individualisé que soit un homme, il reste toujours quelque chose de collectif, la dépression et la mélancolie mêmes qui résultent de ce même individualisme exagéré.
Le suicide altruiste
Mais si une individuation excessive conduit ainsi au suicide, il en va de même d’une individuation insuffisante : ainsi, chez les « peuples primitifs », on trouve plusieurs catégories de suicides, les hommes au seuil de la vieillesse, les femmes à la mort de leur mari, les fidèles et les serviteurs à la mort de leur chef, dans lesquels la personne se tue parce que c’est son devoir. Un tel sacrifice, selon Durkheim, est imposé par la société à des fins sociales ; et pour que la société puisse le faire, la personnalité individuelle doit avoir peu de valeur, un état que Durkheim a appelé l’altruisme, et dont le mode correspondant de mort auto-infligée a été appelé le suicide altruiste obligatoire.
Comme tous les suicidés, l’altruiste se tue parce qu’il est malheureux, mais ce malheur se distingue à la fois par ses causes et par ses effets. Alors que l’égoïste est malheureux parce qu’il ne voit rien de « réel » dans le monde en dehors de l’individu, par exemple, l’altruiste est triste parce que l’individu semble si « irréel » ; l’égoïste ne voit pas de but vers lequel il pourrait s’engager, et se sent donc inutile et sans but, alors que l’altruiste s’engage vers un but au-delà de ce monde, et désormais ce monde est un obstacle et un fardeau pour lui. La mélancolie de l’égoïste est celle d’une incurable lassitude et d’une triste dépression, et s’exprime par un relâchement complet de toute activité ; le malheur de l’altruiste, au contraire, naît de l’espoir, de la foi, voire de l’enthousiasme, et s’affirme dans des actes d’une extraordinaire énergie.
Le suicide altruiste reflète donc cette « morale grossière » qui fait fi de l’individu, tandis que son homologue égoïste élève la personnalité humaine au-delà des contraintes collectives ; et leurs différences correspondent ainsi à celles qui existent entre les sociétés primitives et les sociétés avancées. Mais des suicides altruistes se produisent chez des peuples plus civilisé, chez les premiers martyrs chrétiens et chez les révolutionnaires français, et dans la société française contemporaine, insiste Durkheim, il existe même un « milieu spécial » dans lequel le suicide altruiste est chronique : le suicide militaire de l’armée représente donc une survivance évolutive de la morale des peuples primitifs :
Influencé par cette prédisposition, le soldat se tue à la moindre déception, pour les raisons les plus futiles, pour un refus de permission, une réprimande une punition injuste, un retard dans la promotion, une question d’honneur, une bouffée de jalousie momentanée, ou même simplement parce que d’autres suicides se sont produits sous ses yeux ou à sa connaissance.
Les suicides « contagieux » attribués par Tarde à des causes psychologiques Durkheim insiste donc, s’expliquent plutôt par la constitution morale qui prédispose les hommes à imiter les actions des uns et des autres.
Enfin, la discussion de Durkheim sur le suicide altruiste illustre bien certains des arguments les plus caractéristiques de l’ensemble de l’ouvrage : son rejet de toute définition du suicide faisant appel à des états mentaux subjectifs (motifs, buts, etc.), sa suggestion que les morts auto-infligées reflètent les sentiments moraux les plus généraux des sociétés dans lesquelles elles se produisent, et l’opinion que ces suicides ne sont donc que des expressions exagérées d’un comportement qui, sous une forme plus modérée, serait qualifié de « vertueux ». Quelle que soit la pureté des motifs qui ont conduit au suicide héroïque de Caton, par exemple, il n’était pas différent en nature de celui d’un des chefs polynésiens primitifs de Frazer ; et là où les suicides altruistes reflètent une indifférence courageuse à la perte de sa propre vie (bien qu’à la perte de la vie d’autrui également), sa contrepartie égoïste montre un respect et une sympathie louables pour la souffrance d’autrui (bien qu’un souci d’éviter sa propre souffrance et ses propres sacrifices également).
Le suicide anomique
Le suicide égoïste et le suicide altruiste, comme nous l’avons vu, sont les conséquences respectives de l’intégration insuffisante ou excessive de l’individu dans la société à laquelle il appartient. Mais outre l’intégration de ses membres, une société doit également contrôler et réguler leurs croyances et leur comportement ; et Durkheim insiste sur le fait qu’il existe une relation entre le taux de suicide d’une société et la façon dont elle remplit cette importante fonction régulatrice. Les crises industrielles et financières, par exemple, augmentent le taux de suicide, un fait généralement attribué au déclin du bien-être économique que ces crises produisent. Mais la même augmentation du taux de suicide, observe Durkheim, est produite par une crise qui aboutit à la prospérité économique :
Toute perturbation de l’équilibre, même si elle aboutit à un plus grand confort et à un accroissement de la vitalité générale, est une impulsion à la mort volontaire ».
Mais comment cela peut-il être le cas ? Comment une chose généralement considérée comme améliorant la vie d’un homme peut-elle servir à l’en détacher ?
Aucun être vivant, commence Durkheim, ne peut être heureux si ses besoins ne sont pas suffisamment proportionnés à ses moyens ; car si ses besoins dépassent sa capacité à les satisfaire, il ne peut en résulter que des frictions, des douleurs, un manque de productivité et un affaiblissement général de l’impulsion à vivre. Chez l’animal, bien sûr, l’équilibre souhaité entre les besoins et les moyens est établi et maintenu par la nature physique – l’animal ne peut imaginer d’autres fins que celles qui sont implicites dans sa propre physiologie, et celles-ci sont ordinairement satisfaites par son environnement purement matériel. Les besoins de l’homme, cependant, ne se limitent pas au seul corps ; en effet, au-delà du minimum indispensable qui satisfait la nature lorsqu’elle est instinctive, une réflexion plus éveillée suggère des conditions meilleures, des fins apparemment désirables qui demandent à être satisfaites. Mais les aspirations suggérées par de telles réflexions sont intrinsèquement illimitées : rien dans la psychologie ou la physiologie individuelle de l’homme n’exige qu’elles cessent à un moment plutôt qu’à un autre. Les désirs illimités sont, par définition, insatiables, et l’insatiabilité est une source certaine de misère humaine :
Poursuivre un but qui est par définition inatteignable, c’est se condamner à un état de malheur perpétuel.
Pour que les êtres humains soient heureux, il faut donc que leurs besoins et aspirations individuels soient limités ; et comme ces besoins et aspirations sont le produit d’une conscience sociale réfléchie, les contraintes purement internes et physiologiques dont jouissent les animaux sont insuffisantes à cette fin. Cette fonction régulatrice doit donc être exercée par un organisme extérieur, moral et supérieur à l’individu, en d’autres termes, par la société.
Durkheim insiste sur le fait que le bonheur humain ne peut être atteint que par l’acceptation de contraintes morales (c’est-à-dire sociales).
Mais quel est le rapport avec le suicide ? En bref, lorsque la société est perturbée par une crise, son échelle est modifiée et ses membres sont reclassés en conséquence ; dans la période de déséquilibre qui s’ensuit, la société est temporairement incapable d’exercer sa fonction régulatrice, et l’absence de contraintes imposées aux aspirations humaines rend le bonheur impossible. Cela explique pourquoi les périodes de désastre économique, comme celles de prospérité soudaine, s’accompagnent d’une augmentation du nombre de suicides, et aussi pourquoi les pays longtemps plongés dans la pauvreté ont bénéficié d’une immunité relative contre la mort auto-infligée.
Durkheim a utilisé le terme anomie pour décrire cette condition temporaire de dérégulation sociale, et le suicide anomique pour décrire le type de mort auto-infligée qui en résulte ; mais dans une sphère de la vie, a-t-il ajouté, l’anomie n’est pas une perturbation temporaire mais plutôt un état de chrome. Il s’agit de la sphère du commerce et de l’industrie, où les sources traditionnelles de régulation sociétale, religion, gouvernement et groupes professionnels, n’ont pas réussi à exercer des contraintes morales sur une économie capitaliste de plus en plus déréglementée. La religion, qui autrefois consolait les pauvres et limitait au moins partiellement les ambitions matérielles des riches, a tout simplement perdu la majeure partie de son pouvoir. Le gouvernement, qui autrefois limitait et subordonnait les fonctions économiques, est maintenant leur serviteur. Ainsi, l’économiste orthodoxe réduirait le gouvernement à un garant des contrats individuels, tandis que le socialiste extrême en ferait le « comptable collectif » – et ni l’un ni l’autre ne lui accorderait le pouvoir de subordonner les autres organismes sociaux et de les unir vers un but commun. Même les groupes professionnels, qui autrefois réglaient les salaires, fixaient le prix des produits et de la production, et indirectement le niveau moyen des revenus sur lequel se fondaient les besoins, ont été rendus impuissants par la croissance de l’industrie et l’expansion indéfinie du marché. Dans le commerce et l’industrie, donc :
l’état de crise et d’anomie est constant et, pour ainsi dire, normal. Du haut en bas de l’échelle, la cupidité s’éveille sans savoir où trouver un ultime point d’appui. Rien ne peut la calmer puisque son but est bien au-delà de tout ce qu’elle peut atteindre.
Et c’est ainsi que les professions industrielles et commerciales sont parmi celles qui fournissent le plus grand nombre de suicides, conclut Durkheim.
L’association de ces derniers avec une tendance accrue au suicide avait déjà été observée, mais elle avait été attribuée à la sélection matrimoniale : les couples divorcés sont plus susceptibles d’avoir été recrutés parmi les individus présentant des défauts psychologiques, qui sont également plus susceptibles de se suicider. De manière caractéristique, Durkheim a rejeté ces explications individuelles et psychologiques du suicide et du divorce, estimant plutôt que nous devrions nous concentrer sur la nature intrinsèque du mariage et du divorce eux-mêmes.
Le mariage, explique Durkheim, doit être compris comme la régulation sociale non seulement de l’instinct physique, mais aussi des sentiments esthétiques et moraux qui se sont compliqués avec le désir sexuel au cours de l’évolution. C’est précisément parce que ces nouveaux penchants esthétiques et moraux sont devenus de plus en plus indépendants des nécessités organiques que la régulation morale du mariage monogamique est devenue nécessaire : le divorce serait alors compris comme un affaiblissement de cette régulation matrimoniale, et partout où la loi et la coutume permettent ses pratiques « excessives », l’immunité relative à la mort auto-infligée ainsi garantie est compromise, et les suicides augmentent.
Cependant, comme nous l’avons déjà vu, l’immunité garantie par le mariage seul n’est appréciée que par le mari, les deux partenaires ne participant qu’à l’immunité fournie par la société domestique plus large ; de même, ce sont les maris plutôt que les femmes qui sont affligés par l’augmentation des taux de suicide lorsque les divorces sont excessifs. Pourquoi les taux de divorce n’affectent-ils pas la femme ? La réponse de Durkheim est que la vie mentale des femmes et donc le « caractère mental » de leurs besoins sexuels est moins développée que celle des hommes ; et comme leurs besoins sexuels sont donc plus étroitement liés à ceux de leur organisme, ces besoins trouvent un frein efficace dans la physiologie seule, sans la régulation externe supplémentaire du mariage monogamique exigé par les hommes. Il s’agit là d’une observation dont Durkheim a tiré une déduction peu victorienne : puisque le mariage monogamique n’offre aucune immunité suicidaire à la femme, il constitue une forme gratuite de discipline sociale qu’elle subit sans le moindre avantage compensatoire. La conception traditionnelle du mariage, selon laquelle il a pour but de protéger la femme du caprice masculin et d’imposer à l’homme un sacrifice de ses instincts polygames, est donc manifestement fausse ; au contraire, c’est la femme qui fait les sacrifices et ne reçoit rien ou presque rien en retour.
Le suicide fataliste
Le suicide fataliste se produit lorsqu’une personne est excessivement réglementée, lorsque son avenir est impitoyablement bloqué et que ses passions sont violemment étouffées par une discipline oppressive. Il est à l’opposé du suicide anomique et se produit dans des sociétés si oppressives que leurs habitants préféreraient mourir plutôt que de continuer à vivre. Par exemple, certains prisonniers préféreraient mourir plutôt que de vivre dans une prison où les abus sont constants et la réglementation excessive. Contrairement aux autres concepts qu’il a développés, Durkheim pensait que le suicide fataliste était théorique et n’existait probablement pas en réalité.
En conclusion
A cette classification étiologique des suicides selon leurs causes, Durkheim ajoute une classification « morphologique » selon leurs effets ou manifestations caractéristiques. Des suicides comme celui du Raphaël de Lamartine, par exemple, commis par une humeur morbide de mélancolie, ont été considérés comme la conséquence et l’expression du suicide égoïste, de même que les suicides épicuriens, plus gaiement indifférents, de ceux qui, ne pouvant plus goûter aux plaisirs de la vie, ne voient aucune raison de la prolonger. Le suicide altruiste, comme nous l’avons déjà vu, se caractérise par la conviction sereine d’accomplir son devoir, ou par un élan passionné de foi et d’enthousiasme ; tandis que le suicide anomique, tout aussi passionné, exprime un sentiment de colère et de déception face à des aspirations non satisfaites.
De même qu’il existe différents types de suicide qui se distinguent par leurs causes, il existe différentes espèces d’humeurs ou de dispositions par lesquelles ces types s’expriment. Dans l’expérience réelle, cependant, ces types et ces espèces ne se trouvent pas à l’état pur et isolé ; au contraire, différentes causes peuvent affecter simultanément les mêmes individus, donnant lieu à des modes composites d’expression suicidaire. L’égoïsme et l’anomie, par exemple, ont une affinité particulière l’un pour l’autre,l’égoïste socialement détaché est souvent non régulé aussi (bien qu’habituellement introverti, dépassionné et dépourvu de ces aspirations qui mènent à la frustration), tandis que la victime non régulée de l’anomie est fréquemment un égoïste mal intégré (bien que ses aspirations illimitées empêchent généralement toute introversion excessive). De même, l’anomie peut être associée à l’altruisme, l’engouement exaspéré produit par l’anomie peut coïncider avec la résolution courageuse et consciencieuse de l’altruiste. Même l’égoïsme et l’altruisme, aussi opposés soient-ils, peuvent se combiner dans certaines situations – dans une société en voie de désintégration, des groupes d’individus peuvent se construire un idéal de toutes pièces et s’y consacrer précisément dans la mesure où ils se détachent de tout le reste.
Enfin, Durkheim n’a trouvé aucune relation entre le type de suicide et la nature des actes suicidaires par lesquels la mort est obtenue. Certes, il existe une corrélation entre des sociétés particulières et la popularité de certains actes suicidaires en leur sein, ce qui indique que le choix des moyens suicidaires est déterminé par des causes sociales. Mais les causes qui poussent à se suicider d’une certaine manière, insiste Durkheim, sont tout à fait différentes de celles qui poussent à se suicider en premier lieu ; les coutumes et les traditions d’une société particulière mettent à disposition certains instruments de mort plutôt que d’autres, et attachent des degrés de dignité différents même aux divers moyens ainsi mis à disposition. Si tous deux dépendent donc de causes sociales, le mode de l’acte suicidaire et la nature du suicide lui-même sont sans rapport.
- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026
- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025
- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025
Rejoignez-nous sur Instagram !
Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet