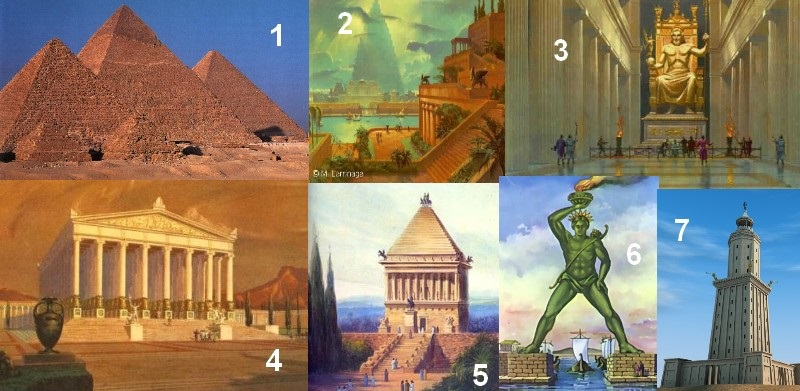Pendant le Moyen Âge (476-1492), les territoires étaient structurés en fiefs et en seigneuries. Bien que théoriquement vassales du roi, ces terres étaient gérées par des seigneurs locaux qui avaient la responsabilité de protéger les populations. En échange de cette protection, les paysans, les artisans et les marchands étaient tenus de payer différentes taxes. Le système fiscal était alors à l’image de la société : fragmenté, arbitraire et profondément inégalitaire.
En bref : Les impôts au Moyen Âge
- Un système inégalitaire : Les impôts variaient selon le statut social (serfs, moines, seigneurs) et le lieu.
- De nombreuses taxes : Il existait des dizaines de taxes différentes, touchant la terre, les récoltes, le travail, le commerce et même le mariage.
- L’arbitraire : Le droit fiscal reposait souvent sur des coutumes orales, ce qui entraînait de nombreux abus de la part des seigneurs.
- Le but : Financer la protection de la population et les biens du seigneur (châteaux, moulins, routes…).

Du Moyen Âge à la Révolution : l’évolution du système fiscal
Jusqu’au XIIIème siècle, le droit fiscal français ne reposait que sur des coutumes orales inconnues de la majeure partie de la population, ne laissant place qu’à l’arbitraire et aux abus, très largement généralisés. De plus, pendant tout le moyen-âge, les habitants étaient soumis à des régimes inégalitaires, en fonction du seigneur sous l’autorité duquel ils étaient. Enfin, étant donné la séparation de la société en différents états, les serfs, moines et seigneurs d’un même territoire, n’étaient pas soumis aux mêmes taxes. Ces inégalités et abus se prolongeront avec la monarchie, notamment sous Louis XIV et seront l’une des principales causes de la Révolution française de 1789. Dès 1790, les impôts les plus arbitraires (par exemple la gabelle ou la dîme) sont supprimés et une vaste politique de réforme fiscale conduit à la refonte du système.
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen va affirmer que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » (Art 1), et que « la loi doit être la même pour tous » (Art 6). Ceci implique qu’un même régime fiscal doit s’appliquer à tous les contribuables placés dans la même situation. De plus l’article 15 est un rempart contre l’arbitraire puisqu’il affirme que la société (donc l’ensemble des citoyens qui la compose) a « le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Avec la République, l’État ne se considère plus au-dessus de ses sujets, mais comme une entité au service des citoyens. Dans le but de financer au mieux cet État au service des citoyens, il est prévu à l’article 13 que la charge de l’État soit « également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ». À l’égalité entre deux contribuables dans la même situation (équité horizontale), s’ajoute donc le principe que ceux qui ont le plus de moyens doivent contribuer davantage.
Découvre dans cet article une liste (quasi- !) exhaustive des différents impôts payés durant le Moyen Âge.
Les impôts majeurs du système féodal
Bien que les taxes médiévales soient innombrables, quatre d’entre elles constituent les piliers du système fiscal et symbolisent à elles seules les rapports de force de l’époque. Ces prélèvements, qui pesaient lourdement sur la vie des paysans, étaient à la fois les fondements économiques de la société féodale et les sources de son profond déséquilibre.
La Taille
La taille était l’impôt direct par excellence, prélevé sur les personnes et leurs biens fonciers. Initialement, elle était une redevance arbitraire, décidée par le seigneur selon ses besoins — d’où le terme de « taillable à merci ». Au fil du temps, elle a évolué pour devenir plus régulière, mais son assiette fiscale, son montant et sa fréquence restaient une prérogative du pouvoir seigneurial, ce qui la rendait particulièrement impopulaire. Un non-noble, un roturier, était par essence « taillable », ce qui faisait de cet impôt non seulement une charge économique, mais aussi un signe d’infériorité sociale. La taille royale est apparue plus tard pour financer le royaume, mais elle reposait sur le même principe d’inégalité.
La Dîme
Instituée par l’Église, la dîme était un impôt religieux prélevé sur la production agricole. Son nom même, dérivé du latin decima, indique qu’elle représentait en théorie un dixième des récoltes des paysans. Ce prélèvement en nature, qui s’ajoutait aux impôts seigneuriaux, était destiné à l’entretien du clergé, des églises et à l’assistance aux plus démunis. Cependant, la perception de la dîme par l’Église, souvent perçue comme la plus riche des institutions de l’époque, était une source de ressentiment pour des populations qui peinaient déjà à survivre de leur travail.
La Gabelle
La gabelle est l’un des impôts les plus célèbres pour son impopularité. Il s’agissait d’une taxe indirecte sur le sel, un produit vital pour l’alimentation et la conservation des denrées. L’État exerçait un monopole sur la production et la vente de sel, obligeant les habitants à en acheter une quantité minimum chaque année. Ce système créait de fortes inégalités régionales : la taxe était si élevée dans certaines provinces (les « pays de grande gabelle ») et si faible dans d’autres que la contrebande, les « faux-sauniers », s’est généralisée. La gabelle devint ainsi le symbole d’une injustice fiscale profonde et arbitraire.
La Corvée
Plus qu’un simple impôt, la corvée était une prestation en travail obligatoire. Les serfs devaient fournir gratuitement leurs bras au seigneur pendant un certain nombre de jours par an pour l’entretien de ses terres, de ses routes ou de ses châteaux. Elle n’était pas un simple échange de service, mais une manifestation physique de la dépendance du serf à l’égard de son seigneur. Cet impôt en nature, qui les détournait de leurs propres travaux agricoles, était l’une des charges les plus lourdes et les plus détestées, renforçant la sujétion de la population rurale.
Liste des impôts au Moyen Âge
| Nom de l’impôt | Description de l’impôt |
| La taille | impôt direct sur la terre et les personnes, proportionnel au revenu ou à la superficie du bien |
| La taille royale | impôt direct au profit du trésor royal, payé principalement par les roturiers. |
| La gabelle | impôt indirect sur le sel, prélevé par l’État sur le produit de sa vente. L’exemption totale ou partielle de la gabelle était appelée le franc-salé |
| Droit de brouage | impôt sur le droit de fabriquer du sel |
| Les aides | impôt exceptionnel prélevé par les seigneurs sur ses vassaux en cas de guerre ou de crise financière |
| La capitation | impôt direct prélevé sur chaque individu, quel que soit son revenu |
| L’octroi | impôt indirect sur les marchandises entrant dans une ville ou une région |
| Le fouage | impôt prélevé sur chaque feu (ou foyer) |
| Les banalités | impôt indirect prélevé par les seigneurs sur les activités artisanales et commerciales dont il finance les installations (four, pressoir, moulin, etc.) |
| L’indire | droit accordé au seigneur de doubler les taxes dans certains cas particuliers |
| La dîme | impôt prélevé par l’Église sur la récolte des paysans correspondant à un dixième de la production |
| Le champart | impôt sur les récoltes, consistant en une part des céréales produites. Cet impôt était prélevé après la dîme |
| La corvée | impôt en travail obligatoire effectué sur le domaine d’un seigneur, pour l’entretien des routes, des ponts et des bâtiments publics, etc. |
| Le cens | impôt foncier payé par le paysan au seigneur en contrepartie de l’utilisation d’une terre (la tenure ou censive) |
| L’afforage | taxe sur le fait de percer un tonneau (mettre un tonneau en perce) afin d’y tirer du vin, par exemple |
| Les lods et ventes | taxe seigneuriale prélevée à chaque fois qu’une terre censive était vendue |
| Les novales | taxe sur les terres nouvellement défrichées et mises en valeur |
| Le tonlieu | impôt indirect sur les marchandises importées ou exportées, plus précisément sur leur transport (par exemple lorsqu’elles franchissent un fleuve) et sur leur étalage dans les marchés |
| La leyde | équivalente au tonlieu mais pour le Midi de la France, avec la particularité de ne s’appliquer qu’aux forains et aux étrangers |
| Le terrage | impôt sur les récoltes de blé (et plus généralement sur ce qui est produit par la terre) |
| Droit de pontonnage | impôt sur l’utilisation de bateaux ou de pontons pour traverser une rivière ou un canal |
| Droit de passage | impôt sur les personnes et les marchandises traversant un territoire |
| Droit de péage | impôt sur les marchandises passant par un pont ou une route |
| Droit de justice | impôt prélevé par les seigneurs sur les condamnations prononcées dans leur juridiction |
| Droit de suite | impôt sur les biens des condamnés à mort |
| Droit de déshérence | impôt sur les biens d’un individu sans héritier |
| La mainmorte | lorsqu’un serf meurt, la majeure partie de ses biens revient à son seigneur |
| Droit d’aubaine | impôt sur les biens des étrangers morts dans le fief du seigneur |
| Droit de retrait lignage | impôt sur les biens vendus hors de la famille |
| Droit de formariage | taxe dont les serfs devaient s’acquitter lors du mariage si l’un d’entre eux provenait d’une seigneurie différente |
| Droit de pacage | impôt sur le droit de faire paître les animaux |
| Droit de pâturage | impôt sur le droit de faire pâturer les animaux |
| Droit de glandage | impôt sur l’utilisation de la forêt pour la cueillette de glands et pour leur utilisation dans le cadre de la nourriture des cochons |
| Droit d’abeillage | impôt sur l’utilisation et la mise en place des ruches d’abeilles |
| Droit de foulerie | impôt sur le foulage des étoffes |
| Droit de mouture | impôt sur la mouture des céréales dans les moulins |
| Le trop-perçu | impôt sur la vente d’une récolte excédentaire |
| Le Franc-fief | taxe à payer au Roi pour l’utilisation d’un fief (en tant que non-noble) |
| La forfuyance | taxe à payer par un serf à son seigneur lorsqu’il souhaite quitter la seigneurie afin de se mettre au service d’un autre seigneur |
Questions fréquentes sur les impôts médiévaux
Qui payait les impôts au Moyen Âge ?
Les impôts étaient principalement payés par les paysans, les artisans et les marchands. Le clergé et la noblesse, qui constituaient les deux premiers ordres de la société, bénéficiaient de larges exemptions fiscales, notamment pour leurs terres.
Quel était l’impôt le plus important ?
Il n’y avait pas un seul impôt dominant. La taille, impôt direct sur les personnes et les terres, était très répandue. La dîme prélevée par l’Église et la gabelle, l’impôt sur le sel, étaient également des taxes majeures et très impopulaires.
Qu’est-ce que la dîme et le champart ?
La dîme était un impôt prélevé par l’Église, représentant un dixième de la récolte. Le champart, quant à lui, était un impôt seigneurial sur les récoltes, prélevé en nature (une partie de la production) après la dîme.
Pourquoi la gabelle était-elle si impopulaire ?
La gabelle était l’impôt sur le sel. Sa grande impopularité venait de son caractère injuste, car le sel était un produit de première nécessité pour la conservation des aliments. L’impôt rendait le sel cher et sa consommation, parfois obligatoire, créait de fortes inégalités entre les régions.
Les impôts étaient-ils les mêmes partout ?
Non, le système fiscal était très fragmenté. Les impôts, leurs montants et leurs noms variaient considérablement d’une seigneurie à l’autre. Le droit fiscal était basé sur des coutumes locales, créant un système inégalitaire et arbitraire.
C’est quoi la corvée ?
La corvée était un impôt prélevé en travail. Les paysans devaient travailler gratuitement sur le domaine du seigneur pendant une période donnée, pour entretenir les routes, les ponts ou les châteaux. C’était l’une des taxes les plus symboliques de la dépendance paysanne.
Qu’est-ce que la mainmorte ?
La mainmorte était une taxe qui s’appliquait à la mort d’un serf. Une grande partie de ses biens revenait alors à son seigneur, qui pouvait ainsi s’assurer de ne pas perdre ses richesses au profit des héritiers.
Quelle est la différence entre la taille et la taille royale ?
La taille était un impôt direct perçu par les seigneurs locaux. La taille royale était une version de cet impôt, perçue directement par le trésor du Roi. Elle touchait principalement les roturiers et était l’une des principales sources de revenus du pouvoir monarchique.
Les impôts du Moyen Âge, complexes et souvent injustes, sont le reflet d’une époque où l’organisation de la société reposait sur un système de dépendance et de privilèges. L’accumulation de ces taxes, basées sur des coutumes orales et l’arbitraire des seigneurs, fut une source de misère et de révoltes qui alimentèrent les tensions sociales pendant des siècles. En comprenant ce système, on saisit mieux le contexte et l’importance des principes d’égalité et d’équité fiscale que la Révolution française a inscrits dans la loi, pour construire un État moderne, au service de tous les citoyens et non plus d’une minorité privilégiée.
Conclusion
Les impôts du Moyen Âge, complexes et souvent injustes, sont le reflet d’une époque où l’organisation de la société reposait sur un système de dépendance et de privilèges. L’accumulation de ces taxes, basées sur des coutumes orales et l’arbitraire des seigneurs, fut une source de misère et de révoltes qui alimentèrent les tensions sociales pendant des siècles. En comprenant ce système, on saisit mieux le contexte et l’importance des principes d’égalité et d’équité fiscale que la Révolution française a inscrits dans la loi, pour construire un État moderne, au service de tous les citoyens et non plus d’une minorité privilégiée.
- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026
- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025
- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025
Rejoignez-nous sur Instagram !
Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet