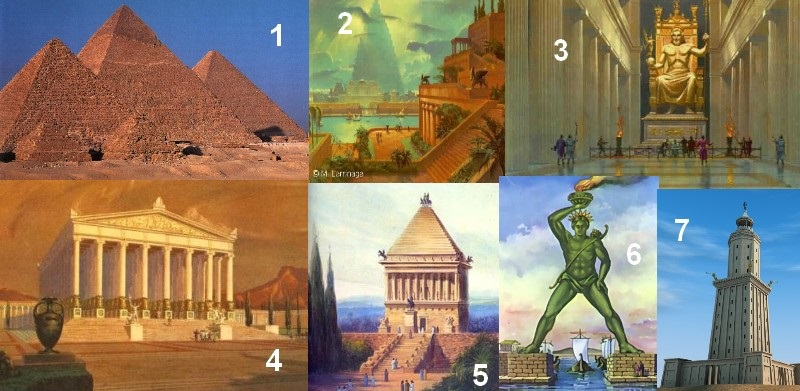Comprendre comment la France organise l’enseignement dans ses colonies à travers la mise en place d’un cadre historique structuré autour de différents angles: celui du professeur, celui de l’image de l’élève, celui de la langue et celui de l’idéologie.
En bref : L’enseignement colonial, un outil idéologique
- L’enseignement colonial est un enseignement « spécial » ou réduit, distinct de celui de la métropole et basé sur la notion de hiérarchie des races (image de l’élève indigène).
- Son objectif principal est la « conquête morale » des populations pour assurer la soumission des masses et le maintien de l’ordre social (écoles pour notables, citadins, et rurales).
- La langue française est un enjeu idéologique majeur (politique de francisation), bien qu’elle soit enseignée de manière « usuelle », sans grammaire ni orthographe, sauf pour les élites.
- L’enseignement est utilitaire, professionnel et manuel pour la masse, visant la rentabilité pour la métropole.
- Des différences existent entre colonies : l’Algérie (colonie-pilote) prône le monolinguisme français dominant, tandis que Madagascar (colonie novatrice) expérimente un bilinguisme contrôlé.
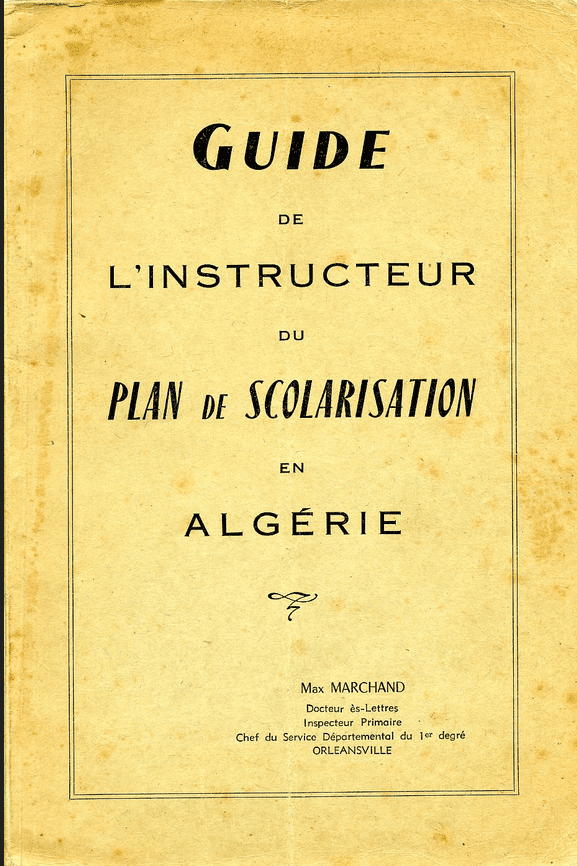
Cadre historique et fondements idéologiques
Pour analyser le système éducatif colonial, il faut d’abord étudier les doctrines sur lesquelles repose l’action éducative :
- Objectifs pris en compte et formulés par le professeur.
- Construction de l’image de l’élève à former.
- Légitimation de la langue pour l’enseignement.
- Participation de l’école à l’idéologie coloniale.
Installation du système scolaire pour les indigènes
Les moyens scolaires ne sont pas les mêmes pour l’enfant de la métropole et l’enfant colonisé. S’opère alors un enseignement réduit ou « spécial » qui se réfère à une certaine image des enfants indigènes, due à la notion de hiérarchie entre les individus.
L’Algérie est considérée comme une « colonie-pilote » par son statut politico-administratif (elle devient un département français dès 1833), tandis que Madagascar est une « colonie novatrice », mettant au point une politique d’enseignement nouvelle.
La création et l’organisation de l’enseignement spécial indigène se sont concrétisées par :
- Le Plan scolaire de 1890 en Algérie.
- L’Arrêté de 1905 à Madagascar.
Aucune grande réforme ne sera entreprise après ces plans jusqu’aux indépendances. La Première Guerre Mondiale marque l’achèvement de l’installation de l’école pour indigènes.
Objectifs de l’enseignement colonial
Avec la constitution des empires coloniaux au 19e siècle, l’enseignement est d’abord pensé pour réaliser la conquête morale des populations autochtones. Cet enseignement public prolonge et complète la conquête militaire.
Cette notion de conquête morale apparaît dans différents textes dès la seconde moitié du 19e siècle. L’objectif est de « former l’esprit des indigènes à nos intentions ». Un des buts est le maintien de l’ordre social.
La structuration des établissements d’enseignement se fait par rapport aux « classes sociales » de la société colonisée. Trois types de populations distinguées et trois types d’écoles parfaitement cloisonnées sont mises en place :
- Les écoles de notables qui ne reçoivent que des enfants de la bourgeoisie.
- Les écoles pour citadins, réservés aux habitants des villes.
- Les écoles rurales qui ont pour objectif de maintenir à la campagne les populations qui s’y trouvent dans « une situation plus heureuse » et non de faire naître chez les enfants le désir d’être fonctionnaire.
Comme l’illustre Georges Hardy, Inspecteur de l’enseignement de l’AOF, dans son *Plan d’études et programmes de l’enseignement des Indigènes* (1920), l’autre objectif est la fusion des races. Dès 1866, il est question de développer par la race européenne la civilisation française en Afrique et en même temps d’améliorer moralement, matériellement les races indigènes jusqu’à ce que, par elles-mêmes, la fusion s’opère par égalité des valeurs.
On peut parler d’altruisme égoïste. Tout est en miroir de la société française. Rappelons que l’action civilisatrice n’est plus considérée comme la justification après coup, mais comme le motif principal des expéditions coloniales (alors que la séparation de l’Église et de l’État date de 1905 en métropole).
Image de l’élève indigène et théories raciales
L’élève indigène est présenté comme un être à part qui souffre de handicaps intellectuels ou culturels. Cette image est utilisée pour justifier un traitement social ou pédagogique spécial, et varie d’une époque à l’autre.
Il est considéré comme le devoir des races supérieures d’éduquer les races inférieures et de leur permettre de rattraper leur retard. Le peuple français est considéré comme une « race historique ». Des fouilles sont menées au Maroc, en Algérie et en Tunisie pour prouver que les Français sont les héritiers des Romains. La période arabe et la période turque n’étant considérées que comme des parenthèses barbares.
Des rapprochements sont faits entre l’organisation de telle ou telle institution indigène et les Français mettent en lumière une proximité entre une institution berbère et la cité française, ce qui fait des Berbères une société vouée à la colonisation. On parle alors d’éducation assimilatrice.
Pour les autres théories faisant de la hiérarchie des races un fossé infranchissable, on parle d’éducation spéciale, différenciée, ou ségrégative.
Choix de la langue d’enseignement : français contre langues locales
À la fin du 19e siècle, l’enseignement du français est un défi international. Il s’agit de constituer une « France asiatique » liée à la France européenne. Le français est enseigné aux Indochinois. Selon les Français, les populations asiatiques sont dociles et leur patois est écrasé par le chinois depuis longtemps et n’ont donc pas de langue à proprement parler.
En ce qui concerne les colonies africaines, l’idée est de poursuivre le même empire linguistique et pour les assimilationnistes de réaliser un enseignement « un peu développé » pour les élites et rudimentaire pour les autres indigènes. Toujours l’idée d’élever la population à un plus haut degré dans la civilisation. C’est l’idée de la langue unique qui permettrait aux différents groupes ethniques de se comprendre.
Par contre, toute une série de mesures administratives et politiques sont réalisées en arabe pour être plus directement comprises par les chefs tribaux. De plus, les langues locales ne sont pas totalement proscrites ou abandonnées. La langue locale, bien que jugée inférieure au français, est considérée comme utile pour être apprise par les fonctionnaires et pour permettre un meilleur enseignement de la religion.
Diffusion de l’idéologie coloniale et différenciation des programmes
L’Algérie est considérée comme la colonie-pilote par son statut politique et administratif. Rappelons qu’elle devient un département français dès 1833 alors que les autres territoires conquis ont été des colonies ou des protectorats. Nous comparons également le cas de Madagascar, qui met au point une politique d’enseignement « novatrice ».
Après le plan de 1890 en Algérie et l’arrêté de 1905 à Madagascar, il ne sera plus vraiment question de réformes jusqu’aux indépendances, hormis quelques modifications mineures. Ces arrêtés ont créé et organisé l’enseignement spécial indigène et son organisation pédagogique.
Les débuts de la politique de scolarisation favorisent les élites dont le concours est indispensable pour installer et pérenniser la domination, et ceci quelle que soit la théorie politique adoptée (assimilative, associative ou adaptative). Les différences de niveaux entre les élèves, surtout au niveau de la langue, empêchent un enseignement unique pour tous. Cette conception de l’enseignement influencera les programmes pédagogiques qui bloqueront les débouchés professionnels pour indigènes.
Similitudes dans les objectifs : l’enseignement utilitaire
Un décret de 1883, entré en vigueur en 1892, instaure le programme d’enseignement spécial pour indigènes en Algérie. L’école devient obligatoire pour toutes les communes d’Algérie. Une prime de 300 francs est accordée aux indigènes connaissant le français.
En 1888, un rapport d’inspection (Leysenne) scolaire dénonce les similarités entre les programmes et les méthodes de la métropole et des écoles algériennes. Dès 1889, l’enseignement est remanié, visant à ne pas déclasser les indigènes mais mettant l’accent sur le côté professionnel.
L’enseignement est divisé en cours préparatoire, élémentaire et moyen. Les programmes sont adaptés à toutes les écoles publiques. L’enseignement est donc utilitaire, professionnel et manuel avec pour objectif de former la masse pour les besoins de rentabilité de la métropole.
Le discours employé est alors civilisateur à portée moralisatrice et insiste sur le fait qu’un des objectifs est le bien-être des indigènes. Les matières prévues sont les mêmes qu’en métropole, avec en plus l’histoire et la géographie de l’Algérie, mais réparties différemment. En métropole, les plans pédagogiques visent une éducation physique, intellectuelle et morale et ne sont pas tournés vers une dominante utilitaire.
À Madagascar, les circulaires de Galieni de 1896 et les arrêtés de 1899 se concentrent sur l’assimilation des indigènes par la diffusion de la langue française. Une volonté d’élévation intellectuelle et morale est visée, mais les circulaires insistent sur leur soumission. L’enseignement est rendu obligatoire pour tous les enfants de 8 à 14 ans dans tous les cantons où il existe une école officielle.
L’enseignement est dit spécial car il est différencié de l’enseignement pour les Français vivant dans les colonies. L’objectif principal est la soumission des masses et leur instrumentalisation.
Différences dans l’allocation horaire des langues
| Langue française | Langue « indigène » | Autres matières | |||||||
| Degré | CP | CE | CM | CP | CE | CM | CP | CE | CM |
| Algérie (Plan de 1898) | 15h | 11h 1/2 | 5h 1/2 | 2h 1/2 | 2h 1/2 | 2h 1/2 | 12h 1/2 | 16h | 22h |
| Madagascar (Plan de 1896) | 8h | 8h | 7h | 7h | 6h | 4h | 15h | 15h | 15h |
| France (Arrêté de 1923) | 17h 1/2 | 14h 1/2 | 12h | / | / | / | 12h 1/2 | 15h 1/2 | 18h |
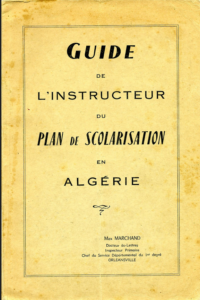
En Algérie, il existe une similarité dans l’organisation du temps scolaire avec la France, avec deux heures d’enseignement de l’arabe en tant que langue étrangère. L’enseignement du français en Algérie et en France occupe la moitié du temps hebdomadaire d’enseignement, illustrant une forte politique de francisation. La réduction du nombre d’heures allouées à l’enseignement de l’arabe est liée à la volonté de contrôler et d’éradiquer cette langue qui reflèterait un panislamisme imminent.
À Madagascar, le temps alloué au français est diminué de presque moitié (7 heures), l’autre moitié étant réservée à la langue malgache. Madagascar sera la première colonie à mettre en pratique une conception bilingue de l’enseignement.
En métropole, l’enseignement est nettement intellectuel. Dans les colonies, il est pratique et utilitaire. Entre 1881 et 1884, sous l’impulsion de Jules Ferry, est décrété l’enseignement de toutes les matières en français.
Cette loi sera transposée en Algérie avec le plan de 1892 pour que le français devienne la seule langue véhiculaire, tandis qu’à Madagascar, le malgache devient la langue véhiculaire dans les premiers degrés d’enseignement dès 1899.
Les instructions de 1899 précisent que le français sera enseigné comme langue seconde, tandis que les langues indigènes seront enseignées comme des langues étrangères (l’arabe parlé plutôt qu’écrit est enseigné, l’arabe littéraire ne le sera qu’aux élites).
Le français parlé élémentaire est favorisé (sauf pour les classes dominantes). Ni grammaire, ni orthographe ne doivent être enseignés. L’importance est mise sur la langue usuelle. Le but est de préparer les enfants à utiliser le français en dehors de l’école pour l’imposer comme langue de communication.
À Madagascar, la politique de francisation a d’abord été assimilatrice, puis associative (enseignement du et en malgache).
Conclusion : entre assimilation et utilitarisme
En Algérie et à Madagascar, les premiers plans scolaires ont prôné un bilinguisme contrôlé (surtout en Algérie) et utilitaire. Les futurs plans favoriseront le passage au monolinguisme français dominant avec la diffusion d’un enseignement français usuel, sauf pour l’élite.
L’enseignement est hiérarchisé, à tendance professionnel et réduit pour la masse et les régions rurales (langue locale, français réduit).
La politique de la métropole n’a pas été totalement « glottophage » (visant l’élimination totale d’une langue), car l’apprentissage des langues indigènes (Algérie + Madagascar) a toujours occupé une place dans l’enseignement, ne fût-ce qu’en langue seconde.
La politique d’assimilation par la langue ne pouvait être totale. En effet, comment diffuser et répandre une langue étrangère (le français) sans reconnaître la nécessité d’une pédagogie spécifique du français comme langue étrangère ? Comment penser que le français pouvait devenir une langue véhiculaire en limitant son apprentissage dans sa qualité et dans sa quantité ? Comment croire à une diffusion du français en ignorant les langues véhiculaires des peuples colonisés ? Le système éducatif colonial, tout en étant un instrument de domination idéologique et d’instrumentalisation économique, a révélé ses propres paradoxes linguistiques et pédagogiques.
FAQ : tout savoir sur l’enseignement colonial français
Quel était l’objectif principal de l’enseignement colonial français ?
L’objectif principal était la « conquête morale » des populations autochtones, qui prolongeait la conquête militaire. Il visait à « former l’esprit des indigènes à nos intentions », à assurer la soumission des masses et le maintien de l’ordre social au service des intérêts de la métropole.
Qu’est-ce que l’enseignement « spécial » pour les indigènes ?
L’enseignement « spécial » ou réduit était un système scolaire différencié et ségrégatif, destiné uniquement aux enfants indigènes. Il était basé sur la notion de hiérarchie des races et proposait des programmes utilitaires, professionnels et manuels, contrairement aux programmes plus intellectuels de la métropole.
Pourquoi l’Algérie est-elle considérée comme une « colonie-pilote » ?
L’Algérie a été désignée « colonie-pilote » en raison de son statut politico-administratif particulier. Devenue un département français dès 1833, elle a servi de laboratoire pour les politiques d’enseignement et d’assimilation, notamment avec le Plan scolaire de 1890.
Comment l’enseignement colonial classifiait-il les élèves indigènes ?
L’enseignement était structuré en fonction de la « classe sociale » de l’élève, créant des écoles parfaitement cloisonnées : les écoles de notables (pour la bourgeoisie), les écoles pour citadins et les écoles rurales (visant à maintenir les populations à la campagne et les éloigner des ambitions de fonctionnariat).
Quelle image de l’élève indigène était véhiculée par l’idéologie coloniale ?
L’élève indigène était perçu comme un être souffrant de « handicaps intellectuels ou culturels » et de « retard » par rapport à la « race historique » française. Cette image justifiait la nécessité d’une éducation « civilisatrice » (ou assimilationniste) pour combler ce fossé.
Quel était le rôle de la langue française dans ce système ?
Le français était l’outil principal de la politique de francisation et de l’assimilation. L’objectif était de l’imposer comme langue véhiculaire. Cependant, il était souvent enseigné de manière rudimentaire et « usuelle » (sans grammaire ni orthographe) à la masse, limitant ainsi l’accès de l’élite à la culture française complète.
Quelle place était laissée aux langues locales (arabe, malgache) ?
Les langues locales étaient considérées comme inférieures au français, mais n’étaient pas totalement éradiquées. Elles étaient parfois tolérées comme langues secondes ou étrangères (comme l’arabe parlé en Algérie), ou utilisées comme langues véhiculaires dans les premiers degrés (comme le malgache à Madagascar) pour faciliter la pénétration de l’idéologie et le maintien de l’ordre.
Pourquoi dit-on que l’enseignement à Madagascar était « novateur » ?
Madagascar est devenue la première colonie à mettre en pratique une conception de l’enseignement qualifiée de « novatrice » par les Français. Après une phase d’assimilation, elle a introduit un bilinguisme contrôlé (malgache comme langue véhiculaire dans les premiers degrés) dans les plans de 1896 et 1899, une approche moins centralisée qu’en Algérie.
Quel est le paradoxe de la politique linguistique coloniale ?
Le paradoxe réside dans la volonté de francisation totale tout en limitant la qualité et la quantité de l’enseignement du français. En ignorant les langues véhiculaires locales et en enseignant un français « usuel », l’administration a freiné sa propre politique d’assimilation linguistique.
Comment l’enseignement était-il utilisé pour la rentabilité économique de la métropole ?
En privilégiant un enseignement utilitaire et manuel pour la majorité des élèves (écoles rurales), le système colonial visait à former une main-d’œuvre locale adaptée aux besoins agricoles et professionnels immédiats de l’exploitation coloniale, assurant ainsi la rentabilité du territoire.
Qu’entend-on par « conquête morale » ?
La « conquête morale » est une doctrine politique qui visait à s’approprier l’esprit des populations colonisées. En instaurant un système scolaire et en diffusant l’idéologie française, la France cherchait à légitimer sa domination et à obtenir le consentement, ou du moins la soumission, des indigènes.
La politique de scolarisation a-t-elle touché toute la population ?
Non. Les débuts de la politique de scolarisation ont largement favorisé les élites indigènes, dont la coopération était jugée indispensable pour l’installation et la pérennisation de la domination française. L’accès à une scolarisation complète restait très limité pour la masse rurale.
Orientations bibliographiques
- ALLIER, R., L’enseignement primaire des indigènes à Madagascar, Paris, Cahiers de la Quinzaine, 1904.
- BARTHELEMY, P., « L’enseignement dans l’Empire colonial français: une vieille histoire ? », Histoire de l’éducation, 128, 2010. 4, en ligne: www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2010-4-page-5.htm (Consulté le 15/12/2011).
- BOUCHE, D., L’enseignement dans les territoires français de l’Afrique occidentale de 1817 à 1920: mission civilisatrice ou formation d’une élite ?, Lille, Atelier de reproduction des thèses, Université de Lille III, 1975.
- CABANEL, P. (dir.), Une France en Méditerranée. Écoles, langue et culture françaises, XIXe-XXe siècles, Paris, Creaphis, 2006.
- CALVET, L.-J., Linguistique et colonialisme, petit traité de glottophagie, Paris, Payot, 1974.
- CHAULET-ACHOUR, C., « Enseigner les indigènes. Aperçu sur l’histoire de l’enseignement en Algérie pendant la colonisation », Le français aujourd’hui, 63, 1983. pp. 100-109.
- DUTEIL, S., « Un instituteur colonial à Madagascar au début du XXème siècle », Histoire de l’éducation, 128., 2010, en ligne: http://histoire-education.revues.org/index2271.html (Consulté le 15/12/2011).
- FITOURI, C., Biculturalisme, Bilinguisme et Education, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1983.
- GIRARDET, R., L’idée coloniale en France de 1871 à 1962, Paris, Hachette, 1978.
- HARDY, G., Une conquête morale. L’enseignement en AOF, Paris, A. Colin, 1917, réédité par L’Harmattan, 2005.
- LEHMIL, L., »L’édification d’un enseignement pour les indigènes », Labyrinthe, 24, 2006, en ligne: http://labyrinthe.revues.org/1252 (Consulté le 15/12/2011).
- LEON, A., Colonisation, enseignement et éducation, étude historique et comparative, Paris, L’Harmattan, 1991.
- MATOUGUI, Z., « L’enseignement du français aux indigènes d’Algérie (1883 – 1962). Valeurs et représentations », dans A. Petitjean et J.-M. PRIVAT (dir.), Histoire de l’enseignement du français et textes officiels. Actes du colloque de Metz, Cresef, 1999, pp.305-334.
- VAAST, P., MEDARD, R., Pédagogie pratique et morale professionnelle (Afrique, Madagascar), Paris, Didier, 1959.
- VIGNON, L., Un programme de politique coloniale. Les questions indigènes. Paris, Plon., 1919.
- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026
- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025
- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025
Rejoignez-nous sur Instagram !
Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet