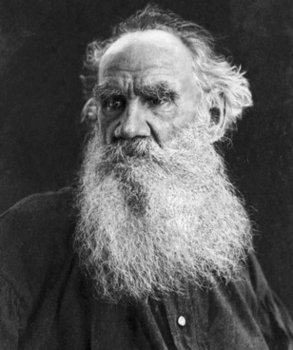En parcourant de nombreux articles et le livre HHhH de Laurent Binet, nous constatons que l’historien est transformé par rapport à son objet d’étude : il le modifie en fonction de son engagement personnel, de ses émotions, ses connaissances et ses croyances d’une part, et des mythes sociétaux et de la période dans laquelle il vit, d’autre part.
Transformé tel l’anthropologue décrit par Mauss dans son essai sur le Don, qui est influencé par son observation d’un peuple, ce dernier se sachant lui-même observé. Parallèlement, le romancier puise son inspiration et le cadre de son intrigue dans les faits historiques.
Les questions soulevées dans cet article sont fondamentales : Quelles sont les frontières entre l’histoire et la littérature ? Sont-elles nécessaires et, plus généralement, sont-elles indispensables dans une société démocratique ? Que permettent-elles ? Quelles sont les influences mutuelles entre la littérature et l’histoire ? Quelles en sont les différences ? Enfin, quel public s’intéresse aux romans historiques et quel en est le succès ?
En bref : Frontières, histoire et littérature
- Le véritable roman historique naît au XIXe siècle. Son succès est lié au besoin de narration et à l’intérêt des lecteurs pour les grandes catastrophes et les bouleversements historiques.
- L’Histoire vise la vérité par une méthodologie scientifique et l’analyse de sources ; la littérature assume le « mentir vrai » pour enrichir la vérité ou en exprimer une autre.
- La frontière entre les deux disciplines passe par l’écriture : l’historien dépend de ses sources et doit dénoncer le « mentir faux », tandis que le romancier peut user de la fiction pour combler les insuffisances des archives.
- La littérature n’est pas passive : elle fabrique du savoir intelligible (œuvres de Balzac, Zola) et constitue une source pour l’histoire culturelle.
- L’existence de ces frontières, même floues, est indispensable aux sociétés démocratiques, car elle permet de distinguer les vérités historiques (factuelles) des vérités littéraires (herméneutiques).
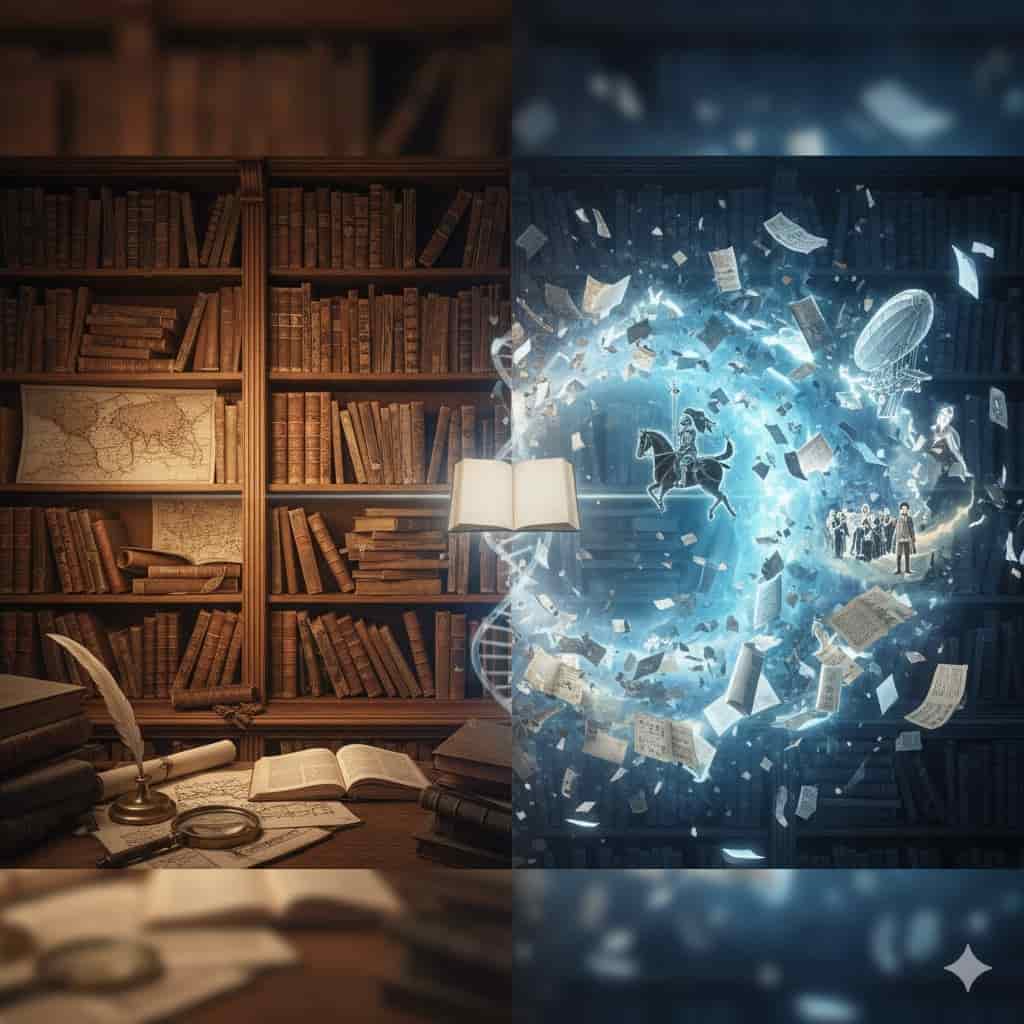
Avènement et succès du roman historique
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’histoire sert de décor ou de fond d’intrigue dans la littérature classique. Avec la Révolution Française, une rupture s’opère ; de l’humanité entre dans l’histoire.
Le concept de l’histoire change et le roman utilise cette évolution pour trouver une nouvelle forme explicitement historique[1]. Au XIXe siècle, le véritable roman historique naît. La période romantique est féconde et plus l’histoire devient une science, plus le roman historique tire sa légitimité du besoin de narration[2].
Avec la Première Guerre Mondiale, le roman historique prend place dans le genre romanesque du XXe siècle. Il relève surtout de l’imagination alors que l’histoire est nourrie par une ambition de connaissance de plus en plus scientifique.
Après la Seconde Guerre Mondiale, un bouleversement s’opère autour du personnage. Le personnage est vu comme acteur individualisé de l’histoire[3], laquelle va hériter des privilèges du roman ; une dimension littéraire entre dans le récit de l’histoire au travers de l’art de la mise en scène et de l’engagement personnel de l’historien. L’historien est transformé par rapport à son objet d’étude.
Le succès du roman historique est expliqué par le fait qu’il entretient un rapport contemporain à une historicité problématique. L’amateur d’histoire voit dans le roman historique une mise en forme séduisante de problématiques. Les lecteurs attendent le récit des grandes catastrophes historiques d’un siècle riche en bouleversements et en confusions[4].
Rapports entre histoire et roman
Les rapports entre histoire et roman ont évolué au cours des dernières décennies. L’histoire en tant que récit du passé humain doit trouver son bien-fondé, sa légitimité, ses caractéristiques dans la quête de la vérité par le biais d’une méthodologie scientifique[5] en rejetant l’imagination et l’invention. L’objet d’étude de l’histoire est problématique et ce serait réducteur de le penser uniquement comme des données quantifiables soumises à l’observation, à l’expérience.
L’histoire vise une interprétation des faits où se mêlent la subjectivité de l’historien et les valeurs, les concepts, de son époque[6]. Selon Gérard Genette[7], on doit admettre qu’il n’existe ni fiction pure ni histoire si rigoureuse qu’elle s’abstienne de toute mise en intrigue ou procédé romanesque. Ce n’est donc pas l’histoire qui fait l’historien, mais l’historien qui fait l’histoire.
La littérature ne peut être considérée comme un acteur passif, elle ne se contente pas de représenter ou d’illustrer des faits. La littérature fabrique également du savoir intelligible par l’histoire culturelle et par l’histoire générale. Citons entre autres les œuvres de Balzac ou de Zola qui se font l’écho de la vie quotidienne et sociale de certaines franges de la population à une époque donnée. Les historiens font entrer la littérature romanesque dans le corpus de leurs sources[8].
On peut parler d’un certain tournant émotionnel de l’histoire. L’analyse des émotions ou des représentations de l’humain obligent à l’invention de sources[9]. Un déplacement du centre de gravité de la recherche historique s’opère, car les sources considérées comme essentielles se révèlent insuffisantes.
La fiction devient alors tentante pour l’historien afin de réaliser une étude sur les émotions ou les représentations qui n’ont laissé aucune trace. « Comment étudier l’histoire de la douleur avec les sources usuelles ? », souligne Alain Corbin[10]. La tentation de passer au roman est forte, mais le risque de sombrer dans un anachronisme psychologique est important.
En s’appuyant sur le probable, l’historien peut donner au lecteur les **clefs** qui lui permettront d’écrire dans sa tête le roman historique. Néanmoins, il est possible d’identifier et de décrire avec précision le quotidien et la vie des soldats dans les tranchées par le biais d’une **archéologie minutieuse** sans avoir recours à la fiction ; c’est ce que Patrick Boucheron nomme une **histoire au ras du sol**[11], à base de sources. L’historien peut faciliter le voyage dans le passé de son lecteur et le mettre en garde contre ce qu’il juge étrange, ou incohérent, sans pour autant user de la fiction[12].
Où sont les frontières ? Le dilemme du « mentir vrai »
Selon Pierre Nora, il doit exister une **frontière nette et claire** entre l’histoire et la littérature qui passe par l’écriture : écriture historique et écriture romanesque[13]. La relation au corps social est l’objet même de l’histoire. Contrairement à l’écriture romanesque, elle est le produit d’un lieu social dont elle découle.
L’histoire est un métier. Écrire l’histoire suppose le recoupement, l’analyse et le traitement de sources. L’historien est dans une démarche, il s’appuie sur une question, sur une tradition déjà constituée par des moyens dont il dépend. Contrairement au roman, l’historien doit dire ce que l’histoire permet et ne permet pas.
Vers un mentir vrai ?
Les romans contemporains sont historiques de manière affichée ou latente[14] de par la contextualisation des intrigues, des questionnements sur la place de la mémoire, des reflets d’une période donnée, etc. La tendance majeure du roman actuel tient dans la dilution du romanesque dans l’historique.
Il est intéressant de reconnaître à la fiction sa légitimité critique. L’histoire accepte le **mentir vrai** et exerce son rôle lorsqu’elle dénonce le **mentir faux**[15]. Le roman emprunte à l’histoire pour situer la nature et la dimension historique de ses personnages. Pour être recevable, la fraude ne doit pas être clandestine.
Laurent Binet, dans HHhH, fait état de ce dilemme permanent entre la restitution d’une scène à base des sources dont il dispose et la tentation d’aller plus loin et de fictionnaliser le récit en ajoutant ce qu’il pense qui se serait réellement passé[16].
Le roman peut tendre à l’expression d’une autre vérité ou à l’enrichissement de la vérité. Il s’agit d’une des prérogatives de la littérature : **faire réfléchir**[17].
Le roman historique permet d’introduire des personnages de **second plan** dans l’histoire, au premier plan. Les grands hommes, eux, passent à l’arrière-plan[18]. Toujours dans **HHhH**, Binet met au premier plan Heydrich, le bras droit d’Himmler, et également les deux Tchécoslovaques Jozef Gabčík et Jan Kubiš, chargés d’assassiner Heydrich.
Le roman a pris une direction herméneutique importante, il est fondé sur la conviction que l’histoire est une « école de liberté » qui favorise la médiation sur l’homme. L’écriture au présent d’un fait passé permet de lire le roman comme un récit qui nous touche de manière contemporaine qui se vit selon la dynamique d’une **enquête policière**[19].
Le passé exploré ne passe pas, la fiction permet de le regarder en face. Le roman historique apparaît comme un **besoin individuel**, en réponse à des interrogations ou des fantasmes[20]. Il appartient au roman d’assumer une part de la vérité du passé. Les historiens livrent leur expertise sur la vraisemblance du récit.
Cas du réel merveilleux : quand la fiction fonde l’identité
Dans cette optique, étudions un cas spécifique d’utilisation du roman, *in extenso* du roman historique et donc, plus globalement de la littérature, comme moyen de permettre à un peuple d’affirmer et de construire son identité.
L’écrivain Alejo Carpentier va écrire un manifeste pour le *real maravilloso* ou réel merveilleux, qui sera la préface de son roman Le royaume de ce monde[24]. Le *real maravilloso* est un mouvement qui s’inscrit dans le discours identitaire latino-américain qui a pour but de rejeter l’influence européenne, de s’en défaire.
Le réel merveilleux est un **objet de foi**, s’intègre spontanément, naturellement dans la réalité au même titre que les faits ou les objets quotidiens. La magie est perçue comme une ouverture à la culture primitive aux mythes les plus archaïques de tout le continent. Le *real maravilloso* participe au patrimoine de toute l’Amérique qui, selon Carpentier, contrairement à l’Europe, n’a pas épuisé tous ses mythes[25].
L’objectif est pour Carpentier de participer à un processus de **reconstruction identitaire** dont l’ambition est de **réécrire l’histoire par l’intermédiaire de la fiction**[26] et d’explorer la spécificité d’une communauté.
Pour réaliser cela, Carpentier se base sur un important travail documentaire et relate sur soixante-dix ans (1750-1820) l’histoire des esclaves d’Haïti, leur révolte, la répression dans le sang, etc. Carpentier fonde son roman de manière historique mais le transfigure par le mythe.
Le roman à la base historique de Carpentier est donc fictionnalisé par des ajouts identitaires, magiques, mythologiques et permet de se démarquer d’une culture qui ne ressemble pas à celle de son peuple. On pourrait parler d’un certain type de **littérature historique militante**, et pour revenir au sous-thème de cette conclusion d’un miroir de notre temps.
Conclusion : le besoin de frontières dans les sociétés ouvertes
Des frontières semblent donc bel et bien exister entre histoire et littérature. Même si les deux disciplines sont connectées, si leurs ressources ou procédés entrent en interaction, la distinction entre les genres peut être effectuée. L’écriture historique, comme l’expose Nora, permet d’établir le distinguo entre la littérature et l’histoire de par sa **scientificité, sa méthode, son traitement de sources**.
Une archéologie minutieuse permet d’échapper à la tentation pour l’historien d’avoir recours à la fiction pour décrire une histoire du quotidien, des émotions.
Il est nécessaire d’avoir des frontières entre les disciplines historiques et littéraires. Qu’elles soient floues, distinctes, ou encore interconnectées, elles sont décelables tantôt par le procédé stylistique utilisé (écriture historique ou écriture romanesque), tantôt par l’admission volontaire de la fraude.
Ces frontières entre les vérités littéraires et les vérités historiques constituent une des prérogatives des **sociétés démocratiques**, des **sociétés ouvertes**[21].
Les fraudes, les emprunts, les ajouts dans les romans ne sont pas gratuits, ils comblent des insuffisances (de la vie, culturelles, historiques par manque de sources). La fiction est un art dans les sociétés où la foi est encline à la remise en question, aux crises, où il y a une incertitude sur le monde[22].
Dans une société fermée, l’histoire s’imprègne de fiction et devient fiction, car elle se crée en fonction des dogmes religieux ou politiques ; la distinction entre la vérité littéraire et la vérité historique disparaît et devient une forme hybride qui fonde, justifie ou soutient la réalité[23].
La légitimité critique du roman historique ne doit pas non plus être dénigrée. Il permet de plonger au présent dans un monde passé et de revivre des événements parfois tombés dans l’interstice des disciplines littéraires et historiques, de remettre au premier plan des « **individus de second ordre** » et de mettre, l’espace d’un roman, les acteurs de premier plan au second.
Le succès qui découle de ce genre littéraire est lié à la dynamique d’intrigues, de rebondissements, d’une écriture au présent et des questions que soulève l’histoire. Rappelons qu’une des prérogatives de la littérature est de faire réfléchir.
Avec leurs moyens propres, l’histoire et le roman se rejoignent dans l’exploration des composantes de l’historicité des hommes, des individus, des sujets : identité, mémoire, héritage. Le roman historique nous parle de nous, aujourd’hui.
FAQ : tout savoir sur le roman historique
Quand le véritable roman historique est-il né ?
Le véritable roman historique a pris son essor au XIXe siècle, pendant la période romantique. Il est apparu à la suite de la Révolution Française, marquant une rupture où l’humanité a fait son entrée dans l’histoire en tant que concept.
Quel est le principal moteur du succès du roman historique ?
Son succès s’explique par le fait qu’il entretient un rapport contemporain à une historicité problématique. Les lecteurs y trouvent une mise en forme séduisante et narrative des problématiques passées, notamment en quête du récit des grandes catastrophes historiques du XXe siècle.
Où se situe la frontière essentielle entre l’histoire et la littérature ?
Selon Pierre Nora, la frontière essentielle réside dans l’écriture : l’écriture historique versus l’écriture romanesque. L’historien est lié à sa méthodologie scientifique et ses sources (quête de vérité), tandis que le romancier peut recourir à la fiction (quête de sens).
Qu’est-ce que le « mentir vrai » en littérature ?
Le « mentir vrai » est la capacité de la fiction à dire une autre vérité ou à enrichir la vérité historique par des ajouts romanesques. L’histoire accepte ce « mentir vrai », mais se doit de dénoncer le « mentir faux » qui serait une fraude clandestine et malveillante.
Comment l’histoire est-elle influencée par l’historien ?
L’histoire n’est pas un simple recueil de faits. Elle est une interprétation où se mêlent la subjectivité de l’historien, ses émotions, son engagement personnel ainsi que les valeurs et les concepts de l’époque dans laquelle il vit.
Comment la littérature peut-elle être une source pour l’historien ?
La littérature, notamment les œuvres de Balzac ou de Zola, fabrique du « savoir intelligible » en se faisant l’écho de la vie quotidienne et sociale d’une époque donnée. Les historiens peuvent donc intégrer ces romans dans le corpus de leurs sources pour l’histoire culturelle.
Pourquoi l’historien est-il parfois tenté par la fiction ?
L’historien fait face à un « tournant émotionnel » qui nécessite d’étudier des sujets n’ayant laissé aucune trace dans les archives traditionnelles (ex. : l’histoire de la douleur ou des émotions). La fiction devient tentante pour combler le manque de sources et éviter un anachronisme psychologique.
Quel est l’apport du roman historique pour les personnages de second plan ?
Le roman historique a pour prérogative d’introduire des personnages de second plan (ou des « individus de second ordre ») sur le devant de la scène. Cela permet de raconter l’histoire par le bas, en reléguant temporairement les grands hommes à l’arrière-plan, comme le fait Laurent Binet dans HHhH.
Que permet l’existence de frontières entre l’histoire et la fiction dans une démocratie ?
L’existence de frontières, même floues ou poreuses, est indispensable aux sociétés démocratiques et ouvertes. Elle permet de distinguer la vérité littéraire (qui interroge, qui est un « mentir vrai ») de la vérité historique (qui repose sur la méthode et les faits).
Qu’est-ce que l’histoire au ras du sol ?
L’histoire au ras du sol est une approche de la recherche historique, défendue par Patrick Boucheron, qui utilise une archéologie minutieuse pour décrire le quotidien et la vie des individus à partir des sources matérielles (à la place de la fiction), même pour des sujets comme la vie des soldats dans les tranchées.
Quelle est la différence entre histoire et fiction dans les sociétés fermées ?
Dans une société fermée, l’histoire s’imprègne de fiction et devient fictionnelle. La distinction entre vérité littéraire et vérité historique disparaît, car le récit du passé est créé pour servir et justifier les dogmes religieux ou politiques en place.
Qu’est-ce que le real maravilloso (réel merveilleux) ?
Le real maravilloso, théorisé par Alejo Carpentier, est un mouvement littéraire latino-américain qui utilise la fiction pour réécrire l’histoire en y intégrant spontanément la magie et les mythes archaïques propres à la culture du continent. Il s’agit d’une démarche de reconstruction identitaire militante.
Que signifie la « dilution du romanesque dans l’historique » dans le roman actuel ?
Cela signifie que le roman contemporain a tendance à intégrer fortement le contexte historique. Les intrigues sont souvent très contextualisées et interrogent la mémoire et la période passée, rendant la dimension purement romanesque moins prégnante.
Quel est l’un des rôles fondamentaux de la littérature ?
Au-delà du divertissement, l’une des prérogatives de la littérature est de faire réfléchir son lecteur. Le roman historique, en particulier, est une « école de liberté » qui favorise la médiation sur l’homme en explorant le passé.
Pourquoi le roman historique nous parle-t-il de nous, aujourd’hui ?
Parce que le passé exploré par la fiction ne « passe » pas ; il est perçu comme un miroir de notre temps. En explorant l’identité, la mémoire et l’héritage, le roman historique répond à un besoin individuel et à des interrogations contemporaines.
Notes bibliographiques:
[1]GENGEMBRE. G., « Le roman historique: mensonge historique ou vérité romanesque ? », in Études, 2010/10, n°413, p.367.
[2]Idem., p. 368.
[3]NORA. P., « histoire et roman: où passent les frontières ? », in Le Débat, 2011/3, n°165, p.7.
[4]GENGEMBRE. G., op. cit., p. 369.
[5]GENGEMBRE. G., « histoire et roman aujourd’hui: affinités et tentations », in Le Débat, 2011/3, n°165, p. 122.
[6]Idem., p. 123.
[7]GENETTE. G., Fiction et diction, Paris, Seuil, 1991, p. 92.
[8]CORBIN. A., « Les historiens et la fiction », in Le Débat, 2011/3, n°165, pp. 57-58.
[9]Idem., p. 59.
[10]Idem., p. 59.
[11]BOUCHERON. P., « On nomme littérature la fragilité de l’histoire », in Le Débat, 2011/3, n°165, p. 54.
[12]Idem., p. 61.
[13]NORA. P., op. cit., p.9.
[14]GENGEMBRE, op. cit., p. 132.
[15]Idem., p. 134.
[16]BINET. L. HhhH, Paris, Poche, 2011, pp. 161-165.
[17]GENGEMBRE. G., op. cit., p.135.
[18]TADIÉ. J.-Y., « Les écrivains et le roman historique au XXè siècle », in Le Débat, 2011/3, n°165, p. 136.
[19]GENGEMBRE. G., « Le roman historique: mensonge historique ou vérité romanesque ? », in Études, 2010/10, n°413, p.372.
[20]TADIÉ. J.-Y., op. cit., p. 144-145.
[21]LLOSA. M. V., La vérité par le mensonge, Paris, Gallimard, 2006, p. 20.
[22]Idem., pp. 16-17.
[23]Idem., p. 22.
[24]CARPENTIER. A., Le royaume de ce monde, Paris, Gallimard, 1954, 221p. Titre original El Reino de este mundo publié en 1949 en espagnol.
[25]PRUD’HOMME. A.-C., Le réel merveilleux chez Yves Thériault et Alejo Carpentier, Montréal, Université de McGill, 2003, pp.15-16; 36-37.
[26]GARNIER. X., Le réalisme merveilleux, Paris, L’Harmattan, 1998, 190p.
- Comment, au snooker, un joueur prévoit sa position plusieurs coups à l’avance - 19 janvier 2026
- Depuis quand fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? - 31 décembre 2025
- Les heures canoniales: matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies - 18 décembre 2025
Rejoignez-nous sur Instagram !
Découvrez nos infographies et astuces : @JeRetiensNet